Les banquiers luxembourgeois, désireux de bénéficier de la manne
provenant des opérations fiduciaires, estimé en 1983 à 11 milliards de dollars,
ont obtenu le règlement grand-ducal du 19 juill. 1983 relatif aux contrats
fiduciaires des établissements de crédit. Par ce contrat, «une personne, le
fiduciant, convient avec un établissement de crédit, le fiduciaire, que le
fiduciaire sera rendu titulaire de droits patrimoniaux, l’actif fiduciaire,
mais que l’exercice de ces droits sera limité par des obligations, le passif
fiduciaire, déterminées par le contrat fiduciaire».
Il est à noter que ce texte a été élaboré par le ministère du Trésor
sans consultation du ministère de la Justice. Fort court, il est muet sur la
situation du bénéficiaire et sur les droits des créanciers du fiduciant et du
bénéficiaire. Un privilège et un droit de rétention ont été institués au profit
du fiduciaire, «véritable hérésie» se sont écriés les civilistes, un
propriétaire ne pouvant être créancier sur son propre patrimoine.
Malgré ces objections de taille, aucun procès n’a surgi quant à
l’application de ce texte qui paraît fonctionner à la satisfaction générale
depuis plus de treize ans.
En outre, le législateur français pourra s’inspirer de la démarche de
son homologue québécois qui a adopté, dans le nouveau code civil,
un régime général de la fiducie.
Le Code civil du Bas Canada de 1866 contenait déjà un régime
embryonnaire au sujet de la fiducie, mais ce régime a donné lieu à des
difficultés d’analyse juridique considérables pour la raison très simple que
l’institution fut conçue dans le contexte où régnait la notion classique du
droit réel, la notion d’un droit de propriété «absolue».
Le nouveau code civil du Québec envisage le renouvellement de la
fiducie sous forme de patrimoine d’affectation. où le cadre juridique du droit
réel est dépassé.
Il importe que la Chancellerie fasse écho de ce qui existe et
fonctionne déjà en matière de fiducie et adopte une bonne fois l’institution de
la fiducie.
En attendant, nous nous proposons de présenter un régime de la
fiducie-sûreté inspiré du trust
anglo-saxon.
Le premier titre de notre étude sera consacré à la notion et à la constitution de la fiducie-sûreté. Nous
essaierons de mieux cerner la notion et pour se faire, nous serons amenés à en
dégager les caractères. Ceux-ci nous
permettrons de justifier alors les
conditions de constitution de la fiducie-sûreté, conditions tenant tant à
la validité qu’à l’efficacité de celle-ci. Le second titre, consacré au régime de la fiducie-sûreté sera pour nous l’occasion de dégager les effets juridiques de la
fiducie-sûreté durant son exécution et lors de son dénouement: nous analyserons
dans un premier temps ses effets entre
les parties contractantes, puis dans un second temps ses effets à l’égard des tiers au contrat.
Avant d’entrer dans les développements, nous tenons à ouvrir une
parenthèse à l’attention du correcteur: la raison qui préside au choix de notre
plan est qu’il est conforme à l’étude logique d’une institution juridique; mais
nous restons conscients qu’il nous amène à considérer certains points sans
grand intérêt par rapport à celui que présente l’analyse des questions
controversées qui se posent en matière due fiducie-sûreté. Aussi, nous avons
choisi des concilier deux objectifs : à la fois présenter un régime complet de
la fiducie-sûreté, et essayer de résoudre, ou du moins, d’apporter des
propositions relativement aux « points chauds » de la matière qui
n’ont pas, pour certains, trouvé réponse, lorsqu’à tout le moins, ils ont été
considérés. Dès lors, un tel choix nous conduira forcément à abréger certains
points pour se consacrer plus longuement à d’autres, alors même que tous
semblent tenir place égale dans notre plan.
L’étude de la
notion de fiducie-sûreté (Chapitre I)
nous permettra de voir comment le contrat de fiducie tel que présenté dans le
projet de loi permet d’être utilisé à fin de garantie et on pourra déjà relever
des différences avec le trust.
Celles-ci se concrétiseront lorsque nous aborderons l’étude des conditions de
constitution de la fiducie-sûreté (Chapitre II).
L’article 2062
futur du code civil définit la fiducie comme le « contrat par lequel un
constituant transfère tout ou partie de ses biens et droits à un fiduciaire
qui, tenant ces biens et droits séparés de son patrimoine personnel, agit dans
un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux
stipulations du contrat ». Cette définition, parce que globale,
n’appréhende pas directement le concept de fiducie-sûreté (Section I) mais elle
met néanmoins en valeur les caractères de l’opération (Section II).
§ 1 L’idée de
propriété utilisée à fin de garantie
A L’idée confrontée
aux règles impératives
La soumission de principe du contrat à l’ordre public
Si la fiducie
utilisée à fin de garantie implique que le transfert de propriété ait lieu à
cette même fin, encore faut-il que cette idée ne transgresse pas de
dispositions d’ordre public.
Force est de
rappeler le souhait des rédacteurs du projet tel qu’énoncé dans l’exposé des
motifs: « ce contrat sera, s’il n’en est disposé autrement, soumis aux
principes généraux du droit des obligations. La fiducie doit en effet
s’intégrer dans l’ordre juridique préexistant, dont elle ne saurait bouleverser
la cohérence. »;
ce souhait est formulé dans le projet à l’article 2062 alinéa 4 futur du code
civil qui dispose: « La fiducie est soumise aux règles ci-après énoncées
sans préjudice des dispositions particulières d’ordre public propres à la
matière concernée. ».
Le contrat de fiducie réalise en soi le transfert de
propriété
Ainsi, des auteurs
ont pu se demander si le seul échange des consentements de l’aliénateur et de
l’acquéreur suffisait à transférer la propriété ou bien si le transfert de la
propriété nécessitait en plus le recours à un contrat nommé (vente, échange,
donation); le cas échéant, le transfert du droit de propriété dans un but de
garantie est inefficace en ce qu’aucun contrat nommé ne réalise un transfert de
la propriété à cette fin. Le problème, résolu pour certains, serait clos par le
projet de consécration législative du contrat de fiducie.
La fiducie ne contrevient pas au principe du numerus clausus
des droits réels
Aussi, on a pu se
demander si le principe du numerus
clausus des droits réels - en considérant que c’est un principe consacré du
droit français - ne
s’opposait pas aux opérations visant à transférer la propriété à fin de
garantie. D’une part il n’en est rien car la fiducie opère un transfert de
propriété sans démembrement de celle-ci, c’est à dire qu’elle opère un
transfert en pleine propriété et ne crée pas de droits réels autres que ceux
contenus dans le numerus clausus ( usus, fructus, abusus). En effet, si la
fiducie vient limiter l’exercice du droit de propriété à son titulaire en ce
qu’elle lui impose des obligations (voir supra),
il ne s’agit que d’obligations strictement personnelles
qui ne restreignent en rien le contenu de son droit de propriété.
D’autre part, notre droit n’aurait rien à gagner à faire jouer un tel principe
pour neutraliser la fiducie-sûreté car nous le jugeons dépassé au regard de
l’utilité économique que l’on peut retirer de la propriété, en témoigne la
fiducie; au surplus, ce principe parait beaucoup plus reposer sur la nécessité
d’une certaine clarté des opérations juridiques que sur l ’essence du
droit de propriété.
De telles questions
ne se posent pas en common law qui ne
connaît pas un tel concept de droit subjectif de propriété: le common law analyse plutôt les situations
juridiques en termes de pouvoirs, en particulier de pouvoirs d’aliénation ;
Ainsi, l’attribution du legal title au
trustee n’indique pas que celui-ci
ait un droit, mais seulement qu’il est habilité à agir. Or, en droit civil,
cette distinction entre droit subjectif et pouvoir
est un produit de la codification napoléonienne inspirée des idées
révolutionnaires, le common law n’a pas connu une telle
rupture.
Le droit de propriété peut être l’accessoire d’un droit
personnel
Des auteurs ont
également soutenu que les caractères du droit de propriété empêchaient ce
dernier d’être constitué en sûreté, c’est à dire d’être l’accessoire d’un droit
personnel, la créance garantie. En effet, le contrat de fiducie est
l’accessoire de la créance garantie et ce caractère accessoire suppose que la
propriété fiduciaire se transmette avec la créance qu’elle garantit. Là encore
il n’est pas choquant que la propriété puisse servir à la garantie d’une
créance et donc lui être accessoire dès lors que les obstacles sont plus
d’ordre philosophique et politique que juridique.
Le numerus
clausus des sûretés réelles « élargi » d’une
nouvelle sûreté
Pour rejeter la
qualification de sûreté à la propriété fiduciaire a t-on pu invoquer le
principe du numerus clausus des
sûretés réelles en vertu
duquel il ne pourrait y avoir de sûretés réelles sans texte.
Peut-on considérer cette question hypothétiquement
close par la consécration législative de la fiducie ? Non si on s’arrête à
l’examen de la définition très générale de la fiducie telle que figurant au
projet et qui ne donne aucun indice explicite permettant une qualification
éventuelle de la fiducie comme sûreté. Cependant, on doit répondre par
l’affirmative quand on sait les raisons qui ont présidées à l’élaboration d’une
définition si générale (cf. introduction); en outre, l’alinéa 3 de l’article
2062 futur du code civil s’intéresse au fiduciaire « lorsque la fiducie
est conclue à des fins de garantie ». Nul doute donc que la consécration
législative de la fiducie conduit à la création d’une nouvelle sûreté.
B La consécration de
l’idée
L’idée est de
transférer la propriété d’un bien dans le but de garantir une créance et
l’intérêt d’une telle consécration est grand au regard des sûretés classiques
lesquelles se révèlent insuffisantes en ce qu’elles ne garantissent plus
suffisamment le créancier du paiement de sa créance. Mais pour mesurer l’ampleur
de cette consécration, il faut garder à l’esprit le fait que l’idée, loin
d’être nouvelle, a déjà été mise en pratique.
Intérêt majeur au
regard de l’inefficacité des sûretés traditionnelles
La loi du 25
Janvier 1985 entérine le privilège accordés aux bénéficiaires de sûretés
traditionnelles. En effet, la finalité première de la loi de 1985 est le
redressement des entreprises viables. Pour ce faire, elle impose à tous les
créanciers, y compris aux privilégiés, les mêmes sacrifices. Or, les sûretés
réelles sont assises sur les biens de l’entreprise et leur exercice peut
compromettre son redressement économique. C’est pourquoi, elles vont se trouver
limitées dans leur valeur, notamment par un paiement tardif
et/ou partiel, voire même
dans leur existence:
ainsi, la créance garantie non déclarée dans le délai légal et ne bénéficiant
pas d’un relevé de forclusion est purement et simplement éteinte, la sûreté
disparaît également par voie accessoire.
En outre, de par
l’accroissement du nombre de créanciers privilégiés et autres super-privilégiés,
la quasi-totalité de l’actif soumis à une procédure collective est absorbée. Le
créancier titulaire d’une sûreté réelle n’a, dans cette hypothèse, aucune
chance d’être désintéressé et le fait de s’aménager un rang préférentiel ne
présente alors plus aucun intérêt puisque ce créancier se trouve dans une
situation semblable à celle du simple chirographaire, à savoir impayé.
Or, cette situation
de « sûretés traquées » mène au « crédit détraqué ».
En effet, les banquiers sont de plus en plus réticents à l’octroi de crédits
aux entreprises ou alors exigent des garanties de plus en plus fortes, voire
complètement disproportionnées par rapport au montant de la dette afin de
compenser le risque d’insolvabilité.
Dès lors, les
créanciers ont cherché la meilleure sûreté, c’est à dire la plus efficace en ce
qu’elle assurera le remboursement de la dette même en cas de procédure
collective ouverte à l’encontre du débiteur. Ils se sont rapidement tournés
vers la « reine des sûretés », la propriété, la considérant comme le
remède efficace aux maux des sûretés réelles traditionnelles.
Intérêt relativisé au regard de techniques contractuelles
similaires
Avant la
consécration de la fiducie-sûreté, l’idée de propriété utilisée à fin de
garantie fondait déjà certaines techniques contractuelles.
Ainsi peut-on
mentionner la vente à réméré,
la clause de réserve de propriété et le crédit-bail,
en quelque sorte détournés de leur fonction première afin de servir de garantie
au crédit fournisseur et bancaire. Le cadre de cette étude ne nous permet pas
de nous attarder sur ces techniques et nous invite à considérer à présent le
mécanisme adopté par le projet.
§ 2 Le mécanisme de
la fiducie-sûreté
En bref, la fiducie-sûreté est un contrat translatif de
propriété à fin de garantie
La fiducie-sûreté
est un contrat qui transfère la propriété d’un ensemble de biens par un
débiteur, le constituant, à son créancier, le fiduciaire, à charge pour ce
dernier de le conserver à fin de garantir le paiement de sa dette par le
débiteur, et de le rétrocéder au terme déterminé par le contrat.
Le transfert
initial de propriété est un effet automatique du contrat, il ne résulte pas de
l’exécution, par le constituant, d’une obligation de donner.
Durant le temps de
la garantie, ie pendant
l’« exécution » du contrat de fiducie-sûreté, le fiduciaire a
l’obligation de conserver le bien.
A la fin de la
fiducie, laquelle interviendra lorsque la garantie n’aura plus lieu de jouer -
et ce pour la simple raison que la dette, dont la fiducie servait à garantir le
remboursement, aura été remboursée - le fiduciaire devra rétrocéder le bien au
constituant-débiteur. Cette rétrocession va procéder de l’exécution de l’obligation,
assumée par le fiduciaire, de rétransférer le bien au terme de la fiducie, et
non comme certains auteurs ont pu l’expliquer, de l’accomplissement de la
condition résolutoire à laquelle le transfert initial de propriété serait
soumis.
Cette présentation
du mécanisme se veut brève, elle en est forcément incomplète. Nous aurons
l’occasion de présenter plus longuement ce mécanisme lorsque nous en étudierons
les caractères. Mais la présentation approfondie du mécanisme ne présente
véritablement d’intérêt que si on sait qui va le mettre en œuvre. Il faut
identifier les « acteurs » de la fiducie, ce que nous nous apprêtons
à faire.
Les acteurs de la fiducie et du trust et la question du cumul
des qualités
En matière de
fiducie-sûreté, le fiduciaire sera le plus souvent, également le bénéficiaire
de la garantie procurée par le droit de propriété. Si cette « double
casquette » est expressément autorisée par le projet de loi,
il n’en va pas de même en matière de trust.
Le trust suppose habituellement trois
personnes, le settlor, le trustee et le beneficiary, mais il peut, comme dans le cadre de la
fiducie-sûreté, n’en comporter que deux.
Mais demeure une différence fondamentale et essentielle: le trustee est nécessairement une personne
distincte du bénéficiaire et il ne saurait y avoir confusion en la même
personne des qualités de trustee et
de bénéficiaire.
Ce principe trouve
son fondement dans la règle selon laquelle, dans la gestion du trust, le trustee doit éviter tout conflit d’intérêts avec lui-même; il ne
peut notamment pas acquérir les biens du trust.
L’idée est de « le garder contre toute incertitude et les risques
d’un abus, de le tenir à l’écart de toute tentation ».
Cela n’est pas sans
rappeler la situation du mandataire qui, selon l’article 1596 du code civil, ne
peut se rendre adjudicataire des biens qu’il est chargé de vendre.
Une telle
préoccupation n’est-elle pas présente dans le projet lorsqu'il dispose à
l'article 2070-1 alinéa premier: " Le fiduciaire exerce sa mission dans le respect de la confiance
du constituant. "? D'ailleurs pourrait-on songer à invoquer contre
le fiduciaire malhonnête l'article 1596 c.civ., cette disposition devant
s'interpréter comme applicable à toute personne chargée des intérêts d'autrui.
Dans ce cas, on assimilerait le fiduciaire aux mandataire, dépositaire et
autres détenteurs de biens d'autrui.
Ainsi, c’est d’une
manière différente que le trust
pourra être utilisé à fin de garantie de paiement: le settlor (débiteur) transfère un bien à un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire (le créancier). On le
voit, ce n’est pas du tout la même opération.
Le trustee étant nécessairement une
personne distincte de celle du bénéficiaire, rien ne s'oppose dès lors à ce que
le settlor soit également trustee. Ainsi, un père de famille qui
partage son patrimoine ou un chef d'entreprise qui veut organiser la
transmission de ses affaires sera désireux de garder un œil sur l'avenir. A cet
effet, un certain nombre de possibilités lui sont ouvertes. D'abord, il peut
devenir partie prenante dans l'opération de trust
notamment en se désignant lui-même comme trustee.
Il peut aussi se déclarer bénéficiaire. Mais une personne ne pouvant pas avoir
des droits uniquement contre elle-même, le constituant ne peut pas se désigner
à la fois comme seul trustee et seul
bénéficiaire. En revanche, deux constituants peuvent se désigner tous deux
comme seuls trustees et seuls bénéficiaires. C'est fréquemment le cas en
Angleterre pour les maisons achetées en commun (cf. Re Cook, 1948, Ch. 212).
Lorsque le
constituant cumule les qualités de trustee
et de bénéficiaire ou bien lorsqu'il s'est réservé d'importantes prérogatives,
on peut se trouver en face d'une opération juridique qui n'a de trust que le nom.
La situation du
constituant d'une fiducie-sûreté est bien différente pour deux raisons tenant
d'une part à la qualification contractuelle de l'opération et d'autre part à la
finalité même de l'opération.
Parce que les
parties au contrat de fiducie sont le constituant et le fiduciaire, on comprend
bien qu'ils ne peuvent être une seule et même personne. Cela reviendrait à
contracter avec soi-même, ce qui est interdit en droit français.
C'est aussi sa qualité de partie au contrat qui différencie le constituant du settlor, lequel "disparaît"
une fois le trust crée.
Aussi, ce cumul ne
permettrait pas le transfert de propriété, élément essentiel de la fiducie, qui
ne peut se faire que d'une personne à une autre.
En outre, un tel
cumul serait contraire à la finalité de
la convention de fiducie-sûreté car il n'y a alors aucune garantie.
De la notion même
de fiducie-sûreté se dégage des différences manifestes avec le trust. Elles le deviennent plus encore
avec l'étude des caractères de la fiducie-sûreté.
L' article 2062
futur du code civil définit la fiducie comme "un contrat par lequel un
constituant transfère tout ou partie de ses biens et droits à un fiduciaire
qui, tenant ces biens et droits séparés de son patrimoine personnel, agit dans
un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux
stipulations du contrat.". De cette définition ressortent nettement les
caractères de l'institution. Les caractères fondamentaux sont la qualification
contractuelle de l’institution (§ 1) et le transfert de propriété affecté à un
but (§ 2).
§ 1 La qualification
contractuelle de l'institution
La Chancellerie a
décidé l'élaboration de ce projet de loi afin d'intégrer une institution qui
puisse concurrencer le trust. Faute
de pouvoir intégrer directement le trust
pour les raisons développées en introduction, on a entrepris d'instituer un
"trust à la française".
Trust et
fiducie, deux opérations de nature juridique différente
Le trust naît d' un engagement
unilatéral du constituant (settlor) qui a transféré des biens à un
tiers ayant vocation à devenir le trustee.
Celui-ci utilisera les biens reçus au profit de bénéficiaires ou dans un but.
Le trust ne naît pas d'un accord de
volontés entre le constituant et le trustee
ou entre le constituant et le bénéficiaire.
S'il y a un accord entre le constituant et le bénéficiaire, par exemple à
l'occasion d'un emprunt, la convention est restreinte à la création future du trust, ce ne peut pas être elle qui crée
le trust. Le trust ne relève donc pas du droit des obligations mais du droit des
biens.
En revanche, la
fiducie est un contrat passé entre le constituant et le fiduciaire, les
bénéficiaires n'en sont pas parties.
Voyons les caractéristiques de ce contrat
avant de considérer les raisons qui ont présidé au choix de la qualification
contractuelle et les difficultés qui en découlent.
La fiducie-sûreté, un contrat unilatéral à titre onéreux
La qualification
contractuelle de l'opération nous mène naturellement à réfléchir à la nature
unilatérale ou synallagmatique de la fiducie.
Le caractère
unilatéral ou synallagmatique du contrat va dépendre de la question de savoir
si le contrat est immédiatement translatif de propriété ou bien s'il met à la
charge du constituant une obligation de donner. Nous opterons pour la première
proposition car nous sommes d'avis à considérer que le contrat est
immédiatement translatif de propriété sans que le constituant ait quelconque
autre formalité à accomplir. Cette rapidité est voulue et son efficacité n'est
pas atténuée par une éventuelle tradition
qui pourrait assortir le transfert et ainsi lui donner une dimension
concrète puisque le constituant va rester en possession du bien donné en
garantie. Ce
mécanisme met en exergue le stade de dématérialisation totale de la propriété
auquel nous sommes parvenus et confère, plus encore que la vente,
une dimension plus grande au principe du consensualisme..
Ainsi le
constituant ne serait tenu d'aucune obligation née du contrat de fiducie.
Peut-on alors conclure que le contrat est unilatéral en ce qu'il ne met des
obligations qu'à la charge d'une des parties, le fiduciaire. Se pose alors le
problème de la cause de l'obligation du fiduciaire.
Nous traiterons cette question lorsque nous étudierons les conditions de
validité du contrat de fiducie.
Nous pouvons
néanmoins remarquer que si le contrat de fiducie est unilatéral, l’opération
économique dans laquelle il s’insère est bien synallagmatique. En effet, la
fiducie-sûreté se combine avec un contrat de crédit pour former une opération
unique d’un point de vue économique. Les deux contrats ne sont pas simplement
juxtaposés mais interdépendants. Le contrat de fiducie n’a été conclu que pour
assurer l’exécution du contrat de crédit. La cause de la fiducie se trouve dans
le contrat de crédit ; en effet, les parties n’auraient jamais conclu une
fiducie si le contrat de crédit n’avait pas été parallèlement conclu. Cela est
logique car la fiducie-sûreté est l’accessoire du contrat principal de crédit.
La fiducie sera le
plus souvent conclue à titre onéreux car comme nous l’avons déjà mentionné, la
confiance se monnaye. Elle n’en demeure pas moins unilatérale.
La fiducie, un contrat commutatif. La fiducie-sûreté, un
contrat aléatoire
La fiducie est un
contrat, en principe, commutatif en ce sens que dès la conclusion du contrat,
les prestations mises à la charge des parties, du moins à la charge du
fiduciaire, sont déterminées. Cela sera d’autant mieux vérifiable que ces
prestations vont faire l’objet de mentions obligatoires dans le contrat de
fiducie.
En effet, ces dernières nous informent notamment sur la mission du fiduciaire
ainsi que sur le sort du bien au dénouement de la fiducie. Dans le cas de la
fiducie-sûreté, le bien sera rétrocédé au constituant.
Force est de
constater cependant que l’exécution conforme de ces prestations va pouvoir
varier en pratique, en fonction notamment de l’exécution, régulière ou non du
contrat dont il est l’accessoire. En effet, nous le verrons,
nous considérons que la fiducie-sûreté est l’accessoire d’un contrat principal,
par exemple un contrat de prêt, le premier ayant été conclu pour garantir le
fiduciaire-créancier des risques d’inexécution par le débiteur-constituant de
son obligation de rembourser sa dette, obligation née du second contrat. On
ressent bien, dès lors l’interdépendance entre ces deux contrats qui fera que
de la bonne marche de l’un (le contrat principal) dépendra celle du contrat
accessoire (la fiducie-sûreté) car accessorium
sequitur principale. Il en résulte un aléa dans l’exécution des prestations
issues du contrat de fiducie. L’événement duquel naîtra le plus souvent l’aléa
sera le remboursement de la dette par son débiteur, le constituant de la
fiducie. En effet, si le débiteur ne rembourse pas sa dette au terme convenu,
le projet prévoit, implicitement, que le fiduciaire ne sera pas tenu de
rétrocéder le bien cédé à titre de garantie.
Ainsi on le voit, l’exécution de cette obligation est fortement aléatoire.
C’est en cela qu’on
peut admettre que le contrat de fiducie, lorsqu’il est utilisé à fin de
garantie et devient dès lors accessoire à un contrat principal, est un contrat
aléatoire.
La fiducie-sûreté, un contrat intuitu personae
La fiducie est un
contrat conclu intuitu personae. Cela
est logique pour un contrat qui repose sur la confiance, fides, que le constituant va mettre dans la personne du fiduciaire.
Un contrat de confiance, à notre époque ou la confiance se monnaye (!),
exige que la loyauté soit « obligée », afin que l’ illoyauté
soit sanctionnée. Le projet prend acte de ces considérations lorsqu’il pose que
« le fiduciaire exerce sa mission dans le respect de la confiance du
constituant ».
De ce caractère intuitu personae en découle directement
une disposition qui impose que le fiduciaire exécute personnellement la mission
qui lui a été confiée par le contrat. Toutefois, l’expérience d’autres contrats
tels que le mandat qui admet que le mandataire se substitue quelqu’un,
a conduit les rédacteurs du projet à admettre une dérogation similaire, tout en
prenant garde à ce qu ’elle ne nuise pas au but de la fiducie: il est
ainsi admis qu’il puisse laisser le soin à un tiers d’accomplir certains actes
à sa place, mais il en est alors responsable.
La fiducie-sûreté, un contrat solennel
Enfin, la
fiducie-sûreté est un contrat solennel. En effet, sa validité exige non
seulement le respect des conditions de fond nécessaires à la formation des
contrats énoncées à l’article 1108 du code civil (nous y reviendrons lors de
l’étude des conditions de formation de la fiducie-sûreté) mais encore la
rédaction d’un écrit lequel doit comporter des mentions obligatoires à peine de
nullité.
Pourquoi recourir à la qualification
contractuelle alors que, nous le verrons, celle-ci est un frein considérable à
l'efficacité de l'institution et donc de la sûreté ?
A Le choix de la
qualification contractuelle
Le contrat, fondement de l’obligation fiduciaire
La qualification
contractuelle est précisément ce qui va justifier les obligations imposées au
fiduciaire, que sa qualité de propriétaire est impuissante à expliquer.
En effet comment
justifier que le fiduciaire-créancier ait l'obligation de conserver le bien
cédé jusqu'au dénouement de la fiducie et ne puisse l'aliéner,
prérogative que sa qualité de propriétaire lui confère? Faut-il rappeler les
caractères exclusif et absolu du droit de propriété auxquels la fiducie, qui
opère un transfert en pleine propriété, sans démembrement de celle-ci, ne porte
aucunement atteinte ? Et que signifie le respect de la confiance du constituant
comme obligation attachée au droit de propriété
? Cette obligation de loyauté lui interdit d'utiliser la propriété qui lui est
transférée à d'autres fins que celles déterminées par la convention de fiducie.
Quel principe peut-on invoquer pour contraindre l'attributaire d'un droit
subjectif à s'interdire certains actes que sa qualité l'autorise en principe à
passer ?
Il ne faut pas
chercher la solution dans la qualité de propriétaire du fiduciaire, et il est
incorrect de dire que les obligations du fiduciaire sont attachées à son droit
de propriété. Bien au contraire, ces obligations sont totalement détachées du
droit de propriété et c'est justement le recours au contrat qui va permettre
d'assurer le respect et l’exécution des obligations fiduciaires.
Les difficultés liées à la qualification contractuelle
L'association de
ces deux "effets" (transfert de propriété et création d'obligations)
va être la source d'incohérence et de contradiction dans les règles applicables
à la fiducie, et partant, d'aléa pour l'interprète de ces règles.
Incohérence et
contradiction en effet car plusieurs articles du projet posent des règles qui
sont en porte à faux par rapport à la qualité attribuée au fiduciaire.
Bien que le
transfert l'ait rendu propriétaire, son titre ne lui confère pas les
prérogatives qui étaient celles du constituant, son ayant-droit. L'étendue des
pouvoirs du fiduciaire est déterminée par le contrat qui fixe aussi le temps
pendant lequel il peut les exercer.
En outre, on exige de l'acquéreur-fiduciaire qu'il remplisse des conditions qui
relèvent de la compétence à exercer une fonction plutôt que de la capacité à
acquérir un droit.
Enfin, les droits acquis par le fiduciaire, bien qu'ils soient de nature
patrimoniale, ne sont pas transmis à son décès à ses héritiers,
ni assujettis aux recours de ses propres créanciers.
Enfin, la
qualification contractuelle de l’opération ne rend pas bien compte de la
pérennité de la fiducie par rapport à la personne du fiduciaire. On devrait
admettre en effet, pour assurer l’efficacité de l’opération (ie l’exécution du but de l’opération)
que les circonstances personnelles au fiduciaire qui peuvent empêcher la
poursuite de sa mission ne mettent pas fin pour autant à la fiducie. Mais tel
n’est pas le cas et les
règles régissant la fin de la fiducie découlent logiquement de sa qualification
contractuelle.
A côté de ces
dispositions qui tendent à limiter les effets de la qualification donnée au
fiduciaire, voire la contredire, il y a celles qui, au contraire s'y rattachent
mais produisent un résultat malencontreux pour la fiducie.
C'est ainsi que la
durée de la fiducie est établie en tenant compte des aléas de la vie du
fiduciaire ou de sa
bonne conduite et on
trouve parmi les causes d'extinction de la fiducie des motifs qui sont
personnels au fiduciaire, telle l'insolvabilité.
Ces causes qui
rendent inaptes une personne à exercer une charge ne devraient logiquement
qu'entraîner le remplacement du fiduciaire par une autre personne.
Les problèmes liés
à cette disparité des fondements qui sous-tendent les dispositions du projet
trouveraient d’emblée une solution si le projet reconnaissait que le
fiduciaire, à l'image du mandataire ou même du trustee, n'exerce qu'une charge pour laquelle il dispose non pas de
droits mais de pouvoirs.
Des difficultés qui n’existent pas en common law
De tels problèmes
ne se posent pas en common law car
c'est précisément le "droit" de propriété du bénéficiaire selon l'Equity (equitable property) qui fonde les obligations du trustee.
Aussi étrange que
cela puisse paraître pour un juriste de droit civil, le trust a la particularité de "transcender" les frontières
du droit des biens et du droit des obligations en admettant que le droit réel
du bénéficiaire
va être la source d'obligations imposées au fiduciaire. Ainsi, parce qu'il est
titulaire d'un "droit" de propriété, le bénéficiaire peut obliger le trustee, qui ne s'est pas engagé envers
lui, à remplir les obligations mises à sa charge par l'acte de trust, le juge ou la loi.
Mais le terme
"obligation" n'est pas à prendre dans son sens civiliste, sens strict
qui classe l'obligation dans les droits qui naissent entre personnes (ius in personam). Il faut admettre
qu'une obligation est aussi un bien (res
incorporalis)
afin de comprendre qu'une obligation puisse naître d'un rapport de personnes
par rapport à un bien.
Ainsi, l'obligation
du trustee peut-elle être qualifiée
d'obligation propter rem (ie à cause de la chose) en ce que le vinculum iuris (lien de droit) entre le trustee et le bénéficiaire ne naît pas
d'un rapport "obligatoire" (issu d'un contrat ou d'un délit) mais est
en quelque sorte fondé sur l'idée d'enrichissement injuste.
Du reste, le recours à cette idée de droit "quasi-réel" pour
justifier l'obligation du trustee est
une fiction. En réalité, le common lawyer
se préoccupe de trouver une solution pratique (practical remedy) au problème qu'il rencontre, avant de réfléchir
éventuellement sur le fondement juridique de la solution à laquelle il est
parvenu. Ces réflexions n'auront alors qu'un intérêt intellectuel.
La qualification contractuelle, début des incohérences du
projet
Si le projet de
loi, en imposant au fiduciaire une obligation de loyauté dans l’exécution de la
fiducie, a essayé d'approximer la situation du trustee, il n'est néanmoins pas parvenu à établir un régime aussi
cohérent que peut l'être celui du trust.
Les rédacteurs du
projet prirent le parti d'attribuer au fiduciaire la qualité de propriétaire
sans accepter d'en tirer toutes les conséquences. Conscients des incohérences
et contradictions auxquelles cette démarche ne pouvait qu'aboutir, ils se sont
limités à n'élaborer qu'un régime très incomplet de la fiducie, laissant à
l'interprète la tâche de rechercher les règles supplétives applicables à la
fiducie. Outre l'aléa que va comporter une telle démarche et les inconvénients
conséquents liés à l'insécurité
juridique, cette situation aboutit à un paradoxe: on voulait un contrat nommé
de fiducie pour plus de sécurité juridique mais la mise en œuvre de ce contrat
n'aboutit qu'à plus d'insécurité juridique !
La qualification
contractuelle n'apporte donc pas entièrement satisfaction quant à la tâche de
combler les obstacles inhérents à l'élaboration d'un "trust à la française".
En outre, elle en
devient une source d'inefficacité.
B Les conséquences
liées à la qualification contractuelle
Soumission au droit commun des contrats
En effet la
qualification contractuelle conduit à soumettre la fiducie au droit des
obligations, à ses règles et principes. Or, sa soumission au principe de la
relativité des conventions va en compromettre gravement l'efficacité.
Soumission au principe de la relativité des conventions,
source d’inefficacité
Un principe fondamental
du droit des obligations est le principe de la relativité des conventions,
principe exprimé à l’article 1165 du code civil.
C’est aux tiers absolus (penitus extranei,
ie ni ayants-causes, ni créanciers de
l’une ou l’autre des parties) que, selon ce principe, le contrat ne nuit, ni ne
profite.
De ce principe, il
découle que les tiers au contrat de fiducie ne seront tenu d’aucune obligation
de ne pas faire et pourront, en toute légalité, acquérir les biens mis en
fiducie que le contrat empêche pourtant au fiduciaire d’aliéner. En effet, si
la convention empêche le propriétaire-fiduciare de disposer librement de son
bien par le biais d’obligations mises à sa charge par le contrat de fiducie,
cette restriction n’engage pas les tiers à la convention.
La soumission du
contrat de fiducie à ce principe en limite donc l’efficacité car la protection
dont devrait pouvoir jouir le fiduciant contre les éventuelles infidélités du
fiduciaire s’en trouve limitée.
L’opposabilité du contrat, remède à cette inefficacité
La solution est à
chercher dans la question de l’opposabilité du contrat aux tiers. En
effet, il est enseigné que le contrat est un fait dont nul ne peut méconnaître
l’existence. La situation de fait ainsi créée peut être opposée aux tiers, en
ce sens qu’ils doivent respecter les droits que le contrat a fait acquérir aux
parties. Ainsi, le tiers doit respecter le droit du constituant à la
rétrocession de la propriété du bien et il leur est interdit de conclure avec
le fiduciaire des conventions qui empêcheraient celui-ci d’exécuter ses
obligations, notamment l’obligation de rétrocéder la propriété. Mais cette
opposabilité ne peut être effective qu’à la condition que le tiers ait eu
connaissance de la situation contractuelle.
Le droit anglais ne
connaît pas un tel principe et donc l’equitable
interest du beneficiary est
opposable à l’éventuel acquéreur du legal
estate entre les mains du trustee.
C’est pourquoi,
afin d’assurer l’efficacité de la fiducie que la qualification contractuelle
tend à amenuiser, on pourrait envisager une publicité du contrat de fiducie.
Car, comme nous le
verrons au second chapitre, l’acquéreur du bien mis en fiducie, en violation du
contrat, sera
protégé par la théorie de l’apparence lorsqu’il aura acquis le bien de bonne
foi. Cette situation, loin d’être une hypothèse d’école, risque souvent de se
rencontrer étant donné que , dans la plupart des situations, le
constituant-débiteur conservera la possession du bien et donc aura, à l’égard
des tiers, l’apparence de propriétaire.
Pareillement, et en
dépit de l’opposabilité erga omnes de
l’equitable interest du bénéficiaire,
le tiers acquéreur de bonne foi (bona
fide purchaser for value without notice) est pleinement protégé par la doctrine of notice,
équivalent de notre théorie de l’apparence; le bénéficiaire ne peut pas exercer
son droit de suite à son encontre.
C’est pourquoi les
anglais ont organisé un système de publicité pour les biens immobiliers:
toutes les terres et biens immobiliers sont répertoriées sur un registre (Land registar) mentionnant tous les estates et interests qui peuvent exister sur ces immeubles.
A cet effet, le
projet de loi semble envisager une éventuelle publicité de la fiducie lorsqu’il
pose à l’article 2070: « Lorsque la fiducie porte sur des droits et biens
dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du
fiduciaire ès-qualités. ». Il faut comprendre que la fiducie donnera lieu
à des formalités d’enregistrement lorsqu’elle entraîne le transfert d’un bien
dont la mutation est soumise à publicité. Nous reviendrons sur cette question
lorsque nous étudierons les conditions liées à l’efficacité de la
fiducie-sûreté.
Le transfert de
propriété ne s’analyse pas comme une condition de formation du contrat. C’est
le second caractère fondamental de la fiducie auquel il nous faut nous
consacrer à présent.
§ 2 Le transfert de
propriété à titre de garantie
La fiducie est un
contrat translatif de propriété passé entre le constituant et le fiduciaire, à
charge pour ce dernier de gérer et/ou de conserver le bien transféré
conformément au but déterminé au contrat et ce, au profit d’un bénéficiaire.
La fiducie-sûreté
suppose, dès la conclusion du contrat, le transfert de propriété d’un bien (A)
du débiteur au profit du fiduciaire, son créancier, affecté (B) à la garantie
du paiement de la dette.
A Un transfert de
propriété
Un effet automatique du contrat
Ainsi, le transfert
de propriété du bien mis en garantie n’est pas une obligation du constituant.
il n’est tenu à aucune obligation de donner.
Le transfert de propriété s’accomplit par le seul effet du contrat de la même
manière que pour la vente
et même encore plus nettement puisqu’il ne s’accompagne d’aucune obligation de
livrer la chose. En outre, l’aliénateur sera admis à conserver le bien en
pleine possession.
De même, le
transfert de propriété des biens au trust
est l’acte essentiel que doit accomplir le constituant s’il veut rendre sa
volonté effective. Force est de constater cependant une différence majeure avec
la fiducie: il ressort de quelques dispositions du projet
que l’acte translatif de propriété sera intégré dans le même document que l’acte contenant les
stipulations du contrat de fiducie, ie
le transfert de propriété se fera concomitamment à la conclusion du contrat de
fiducie; en revanche, le transfert de propriété du bien mis en trust se fera antérieurement à l’acte
constitutif du trust. En effet, la
constitution d’un trust exprès privé
implique que les biens ont été transférés par le constituant à une personne qui
devrait devenir le trustee; une fois
ce transfert réalisé, le trust
proprement dit (instrumentum) peut
être constitué.
Un transfert en pleine propriété
Le constituant doit
transférer le bien en pleine propriété, c’est à dire qu’il ne saurait retenir
un quelconque droit réel dessus, à l’image du settlor-beneficiaryd’un
trust. En revanche, le settlor (débiteur) qui, en matière de trust-garantie ne peut pas être à la
fois beneficiary (pour la simple
raison que le beneficiary sera le
créancier) ne sera pas admis à retenir un interest
sur le bien transféré car ce serait contraire au but du trust: la garantie du paiement de sa dette par le settlor.
En outre, le bien
transféré peut-être un simple droit réel qu’il tient sur une propriété
démembrée, dès lors que le transfert de ce droit est absolu. Le projet rend
possible une telle solution,
laquelle est d’ailleurs admise pour le trust.
Nous y reviendrons quand nous traiterons la question des biens transférés à
titre de garantie.
De la possession à la propriété économique
Le constituant est
admis à conserver la possession de la chose, c’est à dire qu’il va pouvoir en
conserver l’usage.
Dès lors pourrait-on admettre que la fiducie conduit à un démembrement du droit
de propriété entre la propriété juridique alors attribuée au fiduciaire et la
propriété économique attribuée à la personne à qui la propriété sera transférée
à la fin de la fiducie. Il s’agira du constituant en matière de fiducie-sûreté.
Ainsi, à l’image du beneficiary (qui
peut être le settlor), le
propriétaire économique a la jouissance du bien en attendant de se voir
(re)transférer le droit de propriété.
Ainsi faudrait-il
reconnaître au débiteur-possesseur du bien une sorte de droit réel proche du
droit du beneficiary, non seulement
au regard de l’intérêt économique qu’on lui reconnaît sur le bien, mais surtout
en ce que la certitude d’un transfert ultérieur de la propriété du bien vient
sans équivoque limiter le droit de disposer du bien par son propriétaire, le
fiduciaire.
Avant d’exposer les
raisons qui fondent une telle analyse, il faut se rendre à l’évidence qu’à
l’heure actuelle, le droit français n’admet pas un tel démembrement de
propriété en ce
qu’il crée un droit réel non contenu dans le numerus clausus des droits réels.
En revanche, cette analyse peut se prévaloir du soutien du droit fiscal. En
effet, le droit fiscal tend à se fonder sur la réalité économique et non sur
l’apparence juridique afin de déterminer la personne redevable de l’impôt.
Au soutien de cette analyse on peut citer la définition que donne de la fiducie
le Vocabulaire juridique de Capitant
de 1936 qui énonce que la fiducie est le « contrat par lequel l’acquéreur apparent d’un bien s’engage à le lui
restituer à l’aliénateur quand celui-ci aura rempli les obligations qu’il a
envers lui ».
De même, un auteur n’hésite pas à dire: « il ne peut s’agir que
d’une propriété apparente, le maître de l’affaire étant resté véritable
propriétaire ».
Notre analyse
s’inspire de la situation qui existe outre-Manche, mais aussi du régime des
avant-contrats tels que la promesse unilatérale de vente et le pacte de
préference.Voyons comment le common law
appréhende une telle situation avant d’examiner ce qui se passe de comparable
en France.
Le démembrement fonctionnel de la propriété en common law
On a pu, d’une
part, s’inspirer de la situation du beneficiary
du trust en ce que ce dernier, à
l’image du constituant de la fiducie-sûreté, va le plus souvent jouir de la
possession du bien. Or, l’equity lui reconnaît la titularité
d’un « droit réel » (l’equitable
interest) concurrent avec le « droit » du fiduciaire (le legal estate) sur le même bien. Ainsi
dit-on que la propriété du bien est divisée sur une base fonctionnelle. En
effet, le trustee se verra attribuer
le management du bien (~gestion et
disposition) tandis que le beneficiary
profitera de l’enjoyment du bien
(jouissance).
Les rédacteurs du
projet ont délibérément rejeté l’hypothèse de tirer les conséquences d’une
telle similitude entre le trust et la
fiducie lorsqu’ils attribuent la pleine propriété du bien mis en fiducie au
fiduciaire.
Le démembrement temporel de la propriété
En revanche peut-on
s’inspirer d’une autre situation qui naît en dehors du trust. En common law, on
admet qu’une personne puisse acquérir, à un moment donné, un droit futur de propriété (estate in expectancy),
tandis qu’une autre personne se voit attribuée le droit actuel de propriété sur le même bien (estate in possession ).
Bien que l’estate in expectancy (~droit
en attente) ne prendra effet qu’à une date future déterminée par l’aliénateur
(souvent le constituant d’un trust),
le propriétaire in expectancy (appelé
remainder ) est titulaire actuel de
ce droit futur et l’existence actuelle de ce droit va venir limiter la libre
disposition, par le titulaire actuel, de la propriété du bien. En effet, il est
titulaire d’un droit temporaire et il ne pourra l’aliéner que pendant la
période durant laquelle son droit est encore effectif, sachant qu’à la date
fatidique, ce droit, en quelques mains qu’il soit, sera ineffectif. Aussi, à
cette date, il ne pourra pas conserver le bien, ce qui est une prérogative du
droit de disposer. L’estate in expectancy
est un equitable interest dont
l’opposabilité sera assurée par son enregistrement au titre de charge. Le
titulaire ce droit sera pleinement protégé quand il voudra faire valoir son
droit en temps voulu qui, rappelons-le, existe dès son attribution.
On pourrait assimiler
la situation du remainder à celle du
bénéficiaire d’une promesse de vente.
De l’estate in
expectancy au droit du bénéficiaire d’un avant-contrat
préparant un transfert de propriété
En effet, si on
reconnaît au bénéficiaire d’une telle promesse un droit personnel à la
conclusion de la vente à son avantage,
on refuse néanmoins de lui reconnaître un droit réel sur la chose,
objet du contrat de vente. Par ailleurs, au regard des règles gouvernant la
publicité foncière, on refuse d’admettre que la promesse unilatérale de vente
constitue une restriction au droit de disposer.
En revanche, il a été admis que le pacte de préférence constituait une
restriction au droit de disposer
et était, à ce titre sujet à publicité obligatoire.
Le pacte de préférence confère à son bénéficiaire un droit personnel à
l’acquisition de la chose dans le cas où son propriétaire s’engagerait à la
vendre. Cela revient à admettre qu’un droit personnel peut restreindre le droit
de disposer. C’est
encore admettre la spécificité de ce droit personnel en ce qu’il donne à son
titulaire droit à l’affectation du bien à son avantage. En d’autres termes, ce
droit confère à son titulaire une maîtrise faible mais réelle
sur le bien, maîtrise qui le rend indisponible au cas où le propriétaire serait
décidé à le vendre.
Cette indisponibilité juridique n’est autre que l’effet réel de ce droit
personnel.
Ce droit personnel
est donc plus qu’un simple droit de créance. Il s’agit d’un droit à
l’acquisition de la chose, d’un ius ad
rem. Ce droit réel éventuel, par anticipation, a un contenu particulier. On a même pu le qualifier de
« droit personnel d’affectation »
en ce qu’il va permettre l’affectation du bien au profit du titulaire de ce
droit. Cette affectation du droit de propriété est le corollaire, du côté
actif, de la restriction au droit de disposer que supporte le propriétaire.
Pour cette raison,
les bénéficiaires ne sont pas des créanciers chirographaires ordinaires, ils
sont titulaires de droits d’affectation.
Essai de qualification du droit du constituant de la
fiducie-sûreté
Ne peut-on pas
considérer que le constituant dispose, dès la conclusion du contrat de fiducie,
d’ un droit actuel à l’aliénation future (au terme de la fiducie) de la
propriété à son profit ? On peut qualifier ce droit de ius ad rem (~droit à la
chose). Il ne
serait que le corollaire de l’obligation future de rétrocéder la propriété du
bien, pesant sur le fiduciaire et qui, pour refléter l’ « actualité »
du droit du bénéficiaire, se concrétise
par l’obligation actuelle de conserver le bien cédé jusqu’à la fin de la
fiducie.
Partant de ces
analyses, on peut déjà raisonnablement conclure que la fiducie entraîne un
démembrement de la propriété en conférant au fiduciaire un droit de propriété
non absolu mais grevé d’une affectation particulière qui l’empêche de disposer
librement de son bien.
B Un droit de
propriété grevé d’une affectation
Le transfert de
propriété que réalise la fiducie-sûreté est affecté à la garantie du paiement
de la dette due par le débiteur (le constituant) à son créancier (le
fiduciaire).
Cette idée
d’affectation est ce qui fait la supériorité de la fiducie, et partant du trust, sur d’autres institutions telles
que la société en nom collectif.
Pour assurer le respect
de cette affectation et ainsi atteindre l’efficacité du trust quant à cette préoccupation, le projet de loi a pris
délibérément le parti de porter atteinte au principe de l’unité du patrimoine.
Selon cette théorie
dégagée par Aubry et Rau au 19° siècle, toute personne ne peut être titulaire
que d’un seul et unique patrimoine. Tout patrimoine est nécessairement rattaché
à une personne. Il en découle la prohibition du patrimoine d’affectation.
Les biens fiduciaires forment un patrimoine d’affectation
Or, le projet pose
à l’article 2062 futur c.civ.: « La fiducie est un contrat par lequel un
constituant transfère tout ou partie de ses biens à un fiduciaire qui, tenant ces biens et droits séparés de son
patrimoine personnel, agit dans un but déterminé au profit d’un ou
plusieurs bénéficiaires conformément aux stipulations du contrat. ». Cet
article admet, au profit du fiduciaire, la constitution d’un second patrimoine,
distinct de son patrimoine personnel, et affecté à un but déterminé qui est,
dans l’hypothèse de notre étude, la garantie de la dette de son débiteur, le
constituant. Il s’agit là d’un patrimoine d’affectation.
Certes la fiducie
déroge au principe de l’unité du patrimoine. Force est de constater cependant
que d’une part, ce principe n’est pas intangible, et que d’autre part, c’était
une condition nécessaire pour assurer à la fiducie une efficacité comparable à
celle du trust.
Ce principe n’est
pas intangible et le constat qui suit permet de s’en persuader: la loi du 11
juillet 1985 créant l’EURL lui porte une atteinte considérable
puisque l’associé unique se retrouve à la tête de deux patrimoines distincts,
son patrimoine personnel et un
patrimoine « professionnel », ie
comprenant les biens liés à son activité professionnelle. Nous n’ignorons pas,
cependant, que certains auteurs démentent totalement la reconnaissance en droit
français, du patrimoine d’affection.
L’ affectation, condition de protection du but de la fiducie
La création d’un
patrimoine distinct du patrimoine personnel du fiduciaire est indispensable
pour assurer en toute sécurité le but de la fiducie. Aussi, il s’agit de
protéger les intérêts du bénéficiaire, lequel simple titulaire de droit de
créance, est impuissant à agir sur l’utilisation que le fiduciaire-propriétaire
des biens, fera de ces derniers.
En effet, lors de la fiducie, il faut s’assurer que les biens cédés à titre de
garantie vont bien être utilisés à cette fin. Or, tel ne peut pas être le cas
s’ils sont saisis par les créanciers personnels du fiduciaire insolvable
impuissant à honorer des dettes étrangères à l’opération fiduciaire. Les biens
mis en fiducie servent alors à honorer le remboursement de ces dettes. Tel
n’est pas le cas non plus s’ils tombent dans la succession du fiduciaire à sa
mort, alors même que le contrat de fiducie prévoyait la poursuite du contrat en
dépit de cet événement.
Le recours à la
notion de patrimoine d’affectation va permettre de placer les biens transférés
à titre de garantie hors de la portée des ayants-causes du fiduciaire. Ils ne
sauraient l’être, en tout état de cause par les créanciers du constituant
puisqu’ils ne font plus partie de son patrimoine.
Seuls les titulaires de créance nées de la conservation ou de la gestion de ces
biens par le fiduciaire pourront saisir les biens.
Cette solution est logique car ces créanciers ont contribué, par
l’intermédiaire d’opérations effectuées avec le fiduciaire ès-qualité,
à la réalisation du but de la fiducie. Une réserve est néanmoins apportée à
cette règle en faveur des créanciers du constituant dont la sûreté née
antérieurement à la fiducie, bénéficie d’un droit de suite.
Il s’agit d’éviter toute tentative d’organisation d’insolvabilité.
Conséquences liées à la constitution d’un patrimoine
d’affectation
La notion de
patrimoine d’affectation entraîne une nécessaire application de la subrogation
réelle pour éviter que le patrimoine personnel du fiduciaire soit enrichi au
détriment du patrimoine fiduciaire.
La conséquence
pratique de la constitution de cette masse séparée est que le fiduciaire devra
prendre sous sa responsabilité toutes les mesures nécessaires à
l’identification des biens transférés en fiducie (art. 2069 al.1 futur c.civ.).
Patrimoine d’affectation et trust fund
Cette solution
permet de se rapprocher du trust sur
ce point, du moins quant aux règles qui en découlent. Voyons ce qu’il en est.
On peut partir
d’une définition du trust énoncée par
M.Lepaulle, lequel fixe son attention sur la masse de biens affectée au trust, constitutive d’un patrimoine
séparé. « Le trust est une
institution juridique qui consiste en un patrimoine indépendant de tout sujet
de droit et dont l’unité est constituée par une affectation qui est libre dans
les limites des lois en vigueur et de l’ordre public. »
Cette définition met en lumière le fait que les biens du trust sont séparés de tous les autres.
Mais le noyau de
l’opération est l’idée d’affectation. En effet, si tout patrimoine est
nécessairement rattaché à une personne, tel n’est pas le cas du trust . Le trust n’est pas une personne morale,
mais un « patrimoine »affecté.
Selon M.Lepaulle, le trust ne serait
la propriété de personne et serait doté d’une indépendance juridique, en sorte
que les devoirs du trustee et les
droits du bénéficiaire existeraient vis-à-vis du trust et non pas vis-à-vis de l’autre partie.
Nous ne pensons pas
qu’il faille agréer à une telle analyse car si elle présente l’avantage de
trancher le nœud gordien d’une manière élégante, elle ne correspond pas au
droit positif anglais.
En effet et d’une
part, les auteurs anglo-saxons tendent à caractériser le trust par la relation qu’il fait naître entre le trustee et le bénéficiaire ainsi que les
droits de ces derniers. Citons à cet égard la définition proposée par Maitland:
« ...quand une personne a des droits qu’elle est tenue d’exercer pour le
compte d’un autre ou pour l’accomplissement d’un but particulier, elle est dit
avoir ces droits en trust pour
l’autre ou pour le but, et elle est appelée un trustee ».
L’accent est porté sur la titularité, par le trustee, des droits mis en trust,
et donc sur le contrôle qu’il va exercer sur ceux-ci. L’idée de patrimoine
d’affectation ne correspond manifestement pas à la conception que les
anglo-saxons se font eux-mêmes du trust.
D’autre part, le
recours à un tel concept ne présente guère d’utilité puisque, dépourvu d’une
notion de patrimoine comparable à la notre,
le common law ne voit aucune
objection de principe à admettre que les biens du trust échappent au recours des créanciers personnels du trustee. La solution est atteinte
naturellement par le biais du dédoublement de propriété auquel aboutit le trust et qui va avoir pour effet de
protéger l’affectation des biens constitués en trust. En effet, l’equitable
title reconnu au bénéficiaire va lui permettre de restreindre la libre
disposition, par le trustee, de son
titre de propriété, le legal title,
droit concurrent sur le même bien; il pourra également obtenir la rétrocession
des biens aliénés « en rupture du trust »
(in breach of trust ». Ainsi, il
en découle que les biens du trust (trust property) sont en quelque sorte
isolés dans une masse (trust fund)
affectée à la réalisation des buts du trust
et insaisissables par les tiers à l’opération, ayants-causes des parties ou
tiers acquéreur.
Cette règle se trouve répondre efficacement aux problèmes posés en pratique,
cela a suffi pour qu’on l’admette.
Nous verrons les effets de cette règle ainsi que ses limites dans le second
titre consacré aux effets de la fiducie-sûreté.
Mais avant de
s’intéresser aux effets de la fiducie-sûreté, la logique veut que nous nous
intéressions à la constitution de la fiducie-sûreté.
Les conditions de
constitution de la fiducie-sûreté vont refléter les caractères de l’institution
pour la simple raison que ces derniers en découlent directement. Aussi
convient-il de les rappeler: la fiducie est un contrat, c’est le premier
caractère, contrat qui réalise un transfert de propriété affecté à un but,
c’est le second caractère. Voyons comment ces caractères se reflètent dans les
conditions de constitution de la fiducie tenant à la validité de l’opération
(Section I) et dans celles tenant à l’efficacité de l’opération (Section II).
Les conditions de
validité de la fiducie-sûreté tiennent essentiellement à sa qualification
contractuelle en ce qu’elle va soumettre l’opération au droit des obligations.
A ce titre, elle devra répondre aux conditions de fond communes à tous les
contrats telles qu’énoncées à l’article 1108 du code civil. En outre, la
spécificité de ce contrat va justifier qu’il soit soumis à des conditions qui
lui sont propres. Nous ne séparerons pas les analyses de ces deux ordres de
conditions en ce qu’elles se complètent et surtout en ce que les conditions
particulières, lorsqu’elles dérogeront aux conditions communes, canaliseront
l’exigence de ces dernières.
En outre, ce
paragraphe sera l’occasion de voir dans quelle mesure l’ensemble de ces conditions
va refléter les conditions de validité de la constitution d’un trust.
L’article 1108 du
code civil pose quatre conditions essentielles pour la validité d’une
convention. Voyons si elles sont présentes dans la fiducie-sûreté et si des
dispositions particulières du projet n’y dérogent pas.
La première condition tient au consentement des parties. Contracter,
c’est d’abord vouloir. Il faudra s’assurer que les parties ont réellement
exprimé leur consentement de contracter une fiducie-sûreté, ie leur
consentement d’obtenir les effets liés à cette convention.
De la même manière
, on recherchera une « certitude d’intention » de créer un trust. Le plus souvent, elle se déduira
de l’acte qu’une personne a accompli quant à des biens préalablement transférés
dans des conditions régulières. L’acte peut être un écrit signé ou non. Il peut
également résulter d’un comportement,
ce qui est expressément exclu pour la fiducie.
Les rédacteurs ont
été conscients de la gravité des effets d’une telle convention en dérogeant au
principe du consensualisme
par l’exigence de la rédaction d’un
écrit. En effet,
il faut s’assurer que les parties ne voulait pas qu’un simple transfert de
propriété mais une fiducie. La différence est fondamentale au regard de ses
conséquences: le simple aliénateur d’un bien n’aura pas normalement droit à la
rétrocession de son bien au terme de l’exécution du contrat; parallèlement,
l’acquéreur d’un bien à la suite d’un contrat réalisant un simple transfert de
propriété pourra disposer de son bien en toute liberté. Ce souci préside aussi
la disposition du projet au terme de laquelle « la fiducie doit être
expresse ».
On exclut donc une interprétation de la volonté des parties dans le sens d’une
fiducie présumée. On restreint du même coup l’éventail de situations dans
lesquelles sont susceptibles d’apparaître une fiducie comparativement à ce qui
se passe en matière de trusts. Mais surtout, on écarte la sanction originale du
breach of trust fondée sur l’idée
d’un trust implicite, le constructive trust, qui est imposée au trustee lorsque ce dernier a, par
exemple, réalisé des profits personnels avec des biens du trust.
En outre, le
principe du consensualisme subit une autre dérogation tenant au principe du
parallélisme des formes. Un tel principe explique l’article 2064 futur du code
civil lequel prévoit, outre l’écrit, que la fiducie conclue à fin de
transmission à titre gratuit devra être passée devant notaire à peine de
nullité. La justification est tirée de ce que la fiducie est un acte abstrait, ie c’est un cadre qui peut être utilisé
à des fins diverses comme en témoignent ses diverses applications. Or, selon
son utilisation, il va permettre d’accomplir des actes qui, conclus en dehors
de ce cadre, requièrent l’accomplissement de formalités tantôt à peine de
nullité, tantôt à peine d’inopposabilité. Le cas échéant, la fiducie devra se
soumettre aux formalités exigées pour l’acte qu’il permet d’accomplir. Cette
solution n’est autre que l’application du parallélisme des formes, solution que
le projet a tenue à consacrer concernant la transmission à titre gratuit
mais qui devrait être, à notre avis, étendu à d’autres hypothèses. Car, en
effet, nous considérons cette solution bonne en ce que l’absence d’une telle
précaution engendrerait un risque pour l’efficacité générale du contrat de
fiducie: en effet, la fiducie permettrait de faire ce que la loi ne permet pas.
Sa validité serait menacée d’une dénonciation pour fraude à la loi.
Une telle extension
pourrait s’autoriser d’une interprétation par analogie de l’article 2064, même
s’il s’agit là d’une exception au principe du consensualisme.
Nous envisagerons cette hypothèse lors de l’étude des conditions d’efficacité
de la fiducie.
En matière
immobilière, il faudra en outre, pour des raisons d’efficacité, accomplir des
formalités de publicité. Il s’agit là d’une autre dérogation au consensualisme
qui permet, en revanche, de renouer avec les origines.
Nous y reviendrons lors de l’étude des conditions d’efficacité de la
fiducie-sûreté.
Enfin, on devra
s’assurer de l’intégrité du consentement des parties, c’est à dire que leur
consentement n’est pas entaché de l’un des vices énoncés à l’article 1109 du
code civil.
La seconde
condition concerne la capacité de
contracter. Sur ce point, outre les cas d’incapacité du droit commun des
contrats, le projet de loi pose des exigences relativement à la capacité du fiduciaire. En effet, le
projet exige de l’acquéreur-fiduciaire qu’il remplisse des conditions
particulières. A notre
étonnement - faisons preuve de naïveté - , alors que le fiduciaire a la qualité
de propriétaire, ces conditions relèvent de la compétence à exercer une
fonction plutôt que
de la capacité à acquérir un droit. Ces exigences mettent en évidence le
caractère « passif » de la qualité de propriétaire du fiduciaire
puisque, si on lui reconnaît cette qualité, il n’aura que faire de l’exercer.
Ce n’est pas le but recherché par le fiduciaire qui en réalité ne s’intéresse
au titre de propriété que par la sécurité qu’il lui procure. N’est-ce pas là
l’intérêt d’une sûreté ? Ainsi peut-être n’aura-t-il jamais à exercer sa
qualité de propriétaire, notamment si son débiteur honore ses dettes à
l’échéance prévue. En revanche, on peut déceler dans ces conditions une exigence
générale d’intégrité, de probité de la part du fiduciaire. C’est plutôt dans ce
sens, à notre avis, qu’il faut comprendre ces conditions. Il semble par
ailleurs tout à fait logique d’exiger du fiduciaire un minimum d’intégrité car
il représente, ne l’oublions pas, la personne dans laquelle le
débiteur-constituant va placer sa confiance. Ce souci est exprimé à l’article
2070-1 futur du code civil qui rappelle que le « fiduciaire exerce sa
mission dans le respect de la confiance du constituant ». Cette exigence
doit être d’autant plus requise que bien souvent, le fiduciaire sera placé dans
une position de supériorité vis-à-vis du bénéficiaire.
Le droit des trusts
règle le problème le la capacité des « parties » au trust conformément au droit commun.
Il n’y a donc rien de pertinent à signaler, si ce n’est une particularité liée
à un principe de common law selon
lequel Equity do not want for a trustee (~
le droit de l’equity ne requiert pas
nécessairement un trustee). Il en
résulte que même si un trustee est
frappé d’incapacité, le trust survit
à l’absence de trustee.
La troisième
condition est relative à l’objet du
contrat de fiducie. L’objet, c’est ce à quoi le débiteur de l’obligation
est tenu envers son créancier. Nous considérons que le contrat de fiducie est
unilatéral. Dès lors, il n’y a qu’un seul objet : c’est précisément la mission
du fiduciaire, laquelle est de conserver le bien durant le temps de la
garantie; elle implique la rétrocession du bien au dénouement de la fiducie, ie quand la garantie n’a plus lieu de
jouer pour la raison simple que le constituant a remboursé sa dette.
L’objet doit être
déterminable. Il doit
par ailleurs être licite.
L’objet du contrat
sera aisément identifiable en ce qu’il va faire l’objet de mentions
obligatoires.
En effet, le projet
exige, à peine de nullité, que le contrat indique les biens et droits cédés,
définisse la mission du fiduciaire et fixe l’étendue de ses pouvoirs
d’administration et de disposition
.
On retrouve cette
condition en matière de trust à travers
l’exigence de certitude quant aux biens du trust,
ce qu’on appelle certainty of-subject
matter. En
l’absence de certitude quant aux biens sur lesquels porte le trust, il n’y a pas trust. Il n’y a pas non plus de trust,
s’il n’est pas possible de connaître avec certitude les droits de chaque
bénéficiaire sur ces biens et corrélativement les pouvoirs du trustee sur ces biens.
Cette exigence va
en outre permettre de s’assurer que les biens appartiennent bien au
constituant. C’est une condition sine qua
non de la constitution de la fiducie puisqu’elle implique le transfert de
la propriété d’un bien appartenant au constituant . Or nemo dat quod non habet. Il en résulte que, à l’image de la vente,
la fiducie ne peut porter sur des biens appartenant à autrui.
Il est intéressant
de constater qu’une telle possibilité est, à moindre mesure, mais en apparence
seulement, permise en common law. En
effet, il est admis qu’un bénéficiaire puisse créer un trust (sub-trust) sur le
droit qu’il détient dans un trust, ie sur son equitable interest . Le transfert au nouveau trust sera alors limité à l’equitable interest. Or n’oublions pas
que cet interest , sorte de
« droit réel » sur un bien est concurrencé par le legal estate que détient le trustee
du premier trust sur le même bien. Un
« civiliste » peu regardant sur ces distinctions essentielles, parce
que les ignorant, tel un profane s’arrêtant au théâtre des apparences, serait
rapidement conduit à reconnaître dans cette situation une hypothèse de
transfert de la propriété d’autrui. En effet, le trustee prenant des actes de disposition et d’administration
relativement aux biens du trust
serait assimilé au propriétaire, au sens « civiliste » du terme,
tandis que le bénéficiaire, parce qu’il est en possession du meuble ou parce
qu’il occupe l’immeuble, serait assimilé, par exemple, à un simple usufruitier.
Voici le bénéficiaire qui prétend à transférer la propriété du bien dont il a
la jouissance. Notre « civiliste », dupé par les qualités apparentes
des trustee (vu propriétaire) et
bénéficiaire (vu usufruitier), est amené à qualifier cette situation de
transfert de la propriété d’autrui. Or il n’en est rien. Si le bénéficiaire
n’a, en effet, que la « jouissance » (enjoyment) du bien, il n’en demeure pas moins titulaire d’un
véritable « droit » sur la propriété de cette chose. C’est son equitable interest. En outre, il peut
valablement transférer son droit sur le bien sans que cela nuise au titulaire
d’un droit concurrent sur ce même bien
(le trustee titulaire du legal title) ni même se voir reprocher
de transférer la propriété d’autrui . La raison en est que ces deux droits
réels concurrents sur le même bien sont indépendants et séparés par l’effet du trust.
Cette analyse est
transposable à la situation dans laquelle un trustee va créer un trust
à partir du legal estate qu’il
détient (trust upon trust).
La condition tenant
à l’objet ne pose pas de difficultés majeures. Il n’en va pas de même quant à
la quatrième condition.
La cause du contrat constitue la quatrième
condition. La nécessité d’une cause licite dans l’obligation telle
qu’énoncée à l’article 1108 dénue d’effets « l’obligation sans cause, ou
sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ».
La cause d’un
contrat est le but en vue duquel les parties ont contracté.
Quelle peut-être la
cause du contrat de fiducie-sûreté ?
Ce contrat étant
unilatéral, on devra rechercher la cause du contrat dans la cause de
l’obligation du seul débiteur
, c’est à dire dans l’obligation du fiduciaire.
L’obligation du
fiduciaire se décompose en deux temps: pendant la fiducie, (ie période pendant laquelle le bien
transféré doit garantir la dette), le fiduciaire est tenu de conserver le bien
cédé et, à la fin de la fiducie (quand la garantie n’a plus lieu de jouer, ie quand la dette a été remboursée) , il
est tenu de rétrocéder le bien cédé.
Les auteurs
classiques, recherchant la causa proxima
de la fiducie-sûreté (conclue à titre onéreux), auraient considéré qu’il y a là
absence de cause
pour annuler le contrat.
Aujourd’hui, il faut
rechercher la cause de la garantie dans le contrat de base. Ainsi, on pourrait
trouver la cause de la fiducie-sûreté dans la bonne exécution du contrat de
crédit duquel il est l’accessoire. En effet, le fiduciaire s’est engagé à
conserver puis à rétrocéder le bien cédé à titre de garantie parce que le
constituant, débiteur au contrat de crédit, s’est lui-même engagé à rembourser
la somme créditée, à l’échéance prévue au contrat principal, le contrat de
crédit. Il y a ainsi une sorte d’interdépendance des deux contrats: le contrat
accessoire, la fiducie-sûreté, n’existe que parce que le contrat principal, le
contrat de crédit, a été conclu. Ces deux contrats sont en quelque sorte liés
au sein d’une même opération économique: un crédit consenti à l’appui d’une
garantie. Le législateur de 1979 a su faire preuve de « réalisme » en
tirant les conséquences juridiques d’une interdépendance entre deux contrats
(prêt et vente) au sein d’une même opération économique (acquisition d’un
immeuble nécessitant le recours au prêt).
Ces deux opérations se caractérisent pareillement par l’interdépendance des
contrats figurant au cœur de celles-ci.
La perspective d’un
remboursement de la part du débiteur est sans doute souhaitée par le créancier
mais elle est insuffisante à justifier qu’il s’oblige; il ne retire aucun
intérêt autre que celui de voir remboursée la somme qu’il a prêté,
remboursement qu’il était déjà en position d’espérer et d’exiger au terme de
l’exécution du contrat de prêt. pourquoi s’obligerait-il dans l’idée d’obtenir
ce qu’il peut déjà exiger au terme d’un premier engagement, sans avoir à
s’obliger en outre. Nous opterons en définitive pour une autre analyse.
L’analyse la plus
juste, à notre humble opinion, consiste à dire que le contrat de fiducie-sûreté peut constituer en elle-même la cause de l’obligation fiduciaire. En
effet, la cause de l’obligation de conserver la propriété, puis de la
rétrocéder pesant sur le fiduciaire repose dans la confiance que le constituant
a mise en sa personne en lui transférant la propriété des biens. En acceptant
de contracter, le fiduciaire accepte
d’honorer la confiance que lui fait le constituant. Force est de constater que
la doctrine italienne
retient la même analyse, à la seule différence qu’elle l’utilise pour justifier
non pas l’obligation fiduciaire mais le transfert initial de propriété.
Certes vous pourriez reprocher à cette analyse d’être fictive, d’autant plus
que, comme nous le suggérons plus loin, nous considérons que l’idée de
confiance associée à l’intuitu personae
n’a plus vraiment sa place dans le contrat de fiducie-sûreté. Nous en
convenons, mais conservons notre position. En effet, même en l’absence d’un
véritable rapport de confiance sur lequel serait basé le contrat, le contrat de
fiducie-sûreté constitue toujours la cause de l’obligation fiduciaire, cause
qui devient fictive car dans ce cas, le contrat est un acte abstrait. L’acte
abstrait est un acte détaché de sa cause, et dont la validité serait
indépendante du point de savoir si elle existe et si elle est licite. Si notre
système juridique causaliste est réticent à reconnaître l’acte abstrait qui est
le principe en droit allemand, le caractère d’acte abstrait a pu être décelé
dans certaines opérations telles que la garantie autonome ou garantie indépendante
internationale.
Admettre que la fiducie-sûreté est un acte abstrait, c’est clôturer la
discussion au sujet de sa cause.
Ces remarques nous
montrent que la fiducie-sûreté régulièrement créée, en apparence, n’est pas
pour autant placée à l’abri de toute critique. Pour minimiser ce travers, il
faut encore que la fiducie-sûreté soit entourée de précautions liées à son
efficacité. Nous y venons, après l’allocution qui suit liée à l’exigence
d’autres mentions obligatoires à stipuler
au contrat à peine de nullité.
Le projet de loi
impose, à peine de nullité, que soient désignés les bénéficiaires, ou fixées les règles de leur désignation.
Cette exigence correspond à celle du common
law relative à la certitude quant aux bénéficiaires qui se traduit assez
étonnamment par certainty of objects
(certitude quant à l’objet du trust).
Ainsi, l’objet du trust, ce sont les
bénéficiaires ou les buts du trust,
et non les biens constitués en trust
(sujets du trust), lesquels,
s’agissant de la fiducie, représentent l’objet du contrat.
Mais la comparaison est inutile ici et même dangereuse en ce qu’elle reviendrait à
déformer des concepts bien établis: en effet, la notion d’objet en matière de
contrat est bien plus qu’une simple référence au but du contrat, c’est une
notion chargée de sens à ne pas prendre dans son sens courant au risque de
créer des malentendus. Dès lors, elle n’est pas comparable à l’idée d’objet
dans le trust entendu le plus
simplement comme le but du trust.
Cette exigence
correspond également à celle du droit anglais selon laquelle le trust doit être opératoire, c’est à dire
qu’il puisse être mis en œuvre pratiquement, et qu’une juridiction soit à même
d’en assurer le contrôle. Or, un trust
ne peut être mis en œuvre que s’il y a un bénéficiaire susceptible d’agir en
justice pour obliger le trustee à se
conformer à sa mission.
Une telle exigence
est logique car le contrat de fiducie fait naître des obligations à la charge
du fiduciaire. Or, c’est le bénéficiaire qui va être créancier de ces
obligations. Comment s’assurer de l’exécution par le fiduciaire de ses
obligations quand les seules personnes qui peuvent en exiger ne sont ni
identifiées, ni identifiables ? Cette exigence va de soi en matière de
fiducie-sûreté car le bénéficiaire va être le constituant dont on connaît
forcément l’identité puisqu’il est débiteur au contrat principal de crédit.
Le contrat doit en
outre stipuler les conditions du
transfert du bien au bénéficiaire, ou de sa rétrocession au constituant. Il
s’agit là d’organiser les modalités d’exécution de l’obligation de donner
incombant au fiduciaire et exigible au terme stipulé au contrat (le
remboursement de la dette s’agissant d’une fiducie-sûreté.
Enfin, le contrat
doit déterminer « la durée de la
fiducie, qui ne peut excéder 99 ans à compter de la date du contrat. ».
Cette exigence est liée à la prohibition de la clause d’inaliénabilité. Une
exception est néanmoins admise lorsque l’inaliénabilité est temporaire et
justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Le présente exigence du projet
permet, en tout état de cause, de remplir la première condition de l’exception,
à savoir le caractère temporaire de l’inaliénabilité, puisque, au maximum,
l’inaliénabilité sera de 99 ans.
Une telle
préoccupation, inspirée de l’interdiction des trusts perpétuels, se retrouve
dans le droit des trusts. Une règle ancienne de source jurisprudentielle (case law) limitait la durée de validité
des trusts. Le
législateur anglais en a reformulé l’expression.
Il en résulte que la période de validité d’un trust est normalement de vingt et un ans. Si la différence avec la
durée de la fiducie peut paraître surprenante, elle devient tout à fait
justifiée lorsqu’on se remémore que le transfert de propriété des biens mis en trust peut avoir lieu bien avant le
moment où le trust (entendu comme trust document) sera conclu et entrera
en activité. Ce transfert peut même avoir lieu « une vie » avant
l’effectivité du trust.
Or, le délai court du jour où le trust
devient effectif ,
ie au maximum,
« une vie » après le transfert initial de propriété. De sorte que le trust peut durer au maximum aussi
longtemps que la vie d’une personne vivante au moment de sa création, plus une
période de vingt et un ans. La durée totale maximum d’un trust sera, on le voit,
très proche de celle de la fiducie.
Cette allocution,
du reste assez longue, clôt le développement sur les conditions ad validitatem de la fiducie-sûreté.
En guise de
conclusion à cette section, nous ferons remarquer qu’il appartiendra au juge,
en cas de litige sur ce point, d’apprécier si les conditions ci-dessus exigées
sont présentes ou non et qu’en cas de doute, il devra se livrer à une
interprétation de la volonté des parties. Par le biais de cette remarque qui
présente peu d’intérêt en soi, nous tenons en réalité à mettre en exergue un
des rarissimes point commun relativement aux démarche et attitude des juges
français et anglais. Ainsi, de part et d’autre de la Manche se retrouve le
principe d’interprétation selon lequel en cas de doute sur le sens d’une
clause, il faut choisir l’interprétation qui valide et donne effet à la clause.
On pourrait trouver dans cette règle un outil au service d’un rapprochement des
jurisprudences françaises et anglaises, faut-il encore, pour qu’elle fasse ses
preuves, plonger les actes constitutifs dans un flou obscur. Le jeu en vaut-il
vraiment la chandelle ? Nous ne le pensons pas.
Il convient à
présent de s’intéresser aux conditions d’efficacité de la fiducie-sûreté.
Le problème de la preuve de la fiducie entre les parties
Dès lors que la
fiducie a été valablement créée, elle jouera pleinement entre les parties
contractantes, à savoir le constituant et le fiduciaire. Nous admettons que
l’efficacité de
celle-ci entre les parties est suffisamment assurée par l’exigence de l’écrit
quant à l’expression du consentement des parties. En effet, la preuve du
contrat de fiducie pourra être aisément rapportée par chacune des parties se
munissant de l’écrit constatant le contrat et cette preuve sera admissible en
application de l’article 1341 du code civil. Il faut néanmoins mentionner la
possibilité, pour chacune des parties, de se décharger de ses obligations nées
du contrat écrit en rapportant la preuve qu’il s’agit là d’un acte ostensible.
Cette question ne présente pas de particularités propres à la fiducie-sûreté,
nous choisissons dès lors de ne pas nous y arrêter.
La question se
réglera en termes différents en common
law en ce que le trust va pouvoir
être créé par oral. Il en résulte que la preuve testimoniale est admissible
pour prouver l’existence d’un trust
en application de la parol evidence rule.
On peut aisément constater que la position du beneficiary, devant la charge de rapporter la preuve du trust qu’il invoque à son bénéfice,
sera plus délicate que celle de notre bénéficiaire. D’une part en ce qu’il ne
disposera pas toujours d’un écrit. D’autre part et surtout car, à la différence
du bénéficiaire de la fiducie-sûreté (lequel est partie au contrat), le beneficiary n’aura pas, en principe,
participé à la conclusion du trust.
Il lui sera dès lors difficile de rassembler des témoins, d’autant plus qu’en
général, il sera opposé au trustee,
lequel se gardera bien de ne pas dévoiler ses témoins, mais surtout car le trust prendra souvent effet longtemps
après la constitution même du trust.
La question de l’opposabilité de la fiducie-sûreté à l’égard
des tiers
La validité du
contrat sera bien souvent impuissante à le rendre assurément efficace à l’égard
des tiers en raison du principe de l’effet relatif des contrats auquel la
fiducie est naturellement soumise.
Il en résulte que
le contrat de fiducie, qui ne peut ni profiter ni nuire aux tiers, n’impose
aucune obligation de ne pas faire à ces derniers. Ils pourront dès lors, sous
couvert de leur ignorance de l’existence du contrat, acquérir efficacement le
bien du fiduciaire. Le tiers pourra invoquer à son profit la théorie de
l’apparence: ignorant la qualité de fiduciaire de la personne de qui il tient
son droit, il a valablement pu acquérir ce droit de ce fiduciaire qu’il croyait
simple propriétaire mais qui était en
réalité un propriétaire-fiduciaire. Dès lors, il ne pourra pas se voir reproché
d’avoir violé le contrat compris comme situation de fait. Il en résulte, pour
la fiducie, que le fiduciaire ne pourra plus exécuter son obligation de
rétrocéder la propriété au constituant pour la simple raison que Nemo plus juris ad alium transferre potest
quam ipse habet, on ne peut transférer à autrui plus de droit qu’on en a
soi-même. Le tiers est devenu propriétaire, le constituant ne peut plus
efficacement l’être car prior tempore
potior jure, celui qui est le premier dans le temps, en droit, l’emporte.
Les effets de la fiducie-sûreté sont neutralisés. Elle n’est plus efficace.
L’identification des éléments à « opposer » aux
tiers
Pour assurer
l’efficacité de la fiducie-sûreté, il va falloir s’assurer d’une part, de
l’opposabilité de la qualité de propriétaire du fiduciaire et d’autre part, de
l’opposabilité de la qualité de fiduciaire de ce propriétaire. Cette précaution
est double car deux ordres de difficultés peuvent émerger de la situation
apparente.
D’une part, il faut
prévenir l’action d’un tiers acquéreur qui prétendrait tenir son droit du
constituant en ce que ce dernier, conservant la possession du bien cédé, va
revêtir, aux yeux du public, l’apparence d’un propriétaire. C’est le premier
ordre de difficultés.
D’autre part, le
second ordre de difficultés tient de ce qu’un tiers acquéreur, à l’exemple du
tiers qui pensait traiter avec un mandataire, pourrait se prévaloir de l’apparence
que le fiduciaire revêt d’un propriétaire pour prétendre avoir valablement
acquis « absolument » le bien, ie
grevé de toute affectation. Le constituant ne pourrait retrouver la propriété
de son bien au terme de la fiducie. Notre acquéreur de bonne foi parce
qu’ignorant échapperait aux conséquences de la responsabilité que le
constituant pourrait lui imputer pour ne pas avoir respecté la situation de
fait créée par le contrat. Il s’agirait là d’une responsabilité délictuelle
fondée sur la faute dommageable de l’article 1382 du code civil. Cette
situation est d’autant plus probable que la présomption de bonne foi dont
bénéficie par principe tout un chacun,
et donc le tiers acquéreur, est complétée par les rédacteurs du projet:
l’article 2068 futur du code civil dispose : «Dans ses rapports avec les
tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur les
biens et droits objet du contrat, à moins qu’il ne soit démontré que les tiers
avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs. ».
Il y a là une véritable consécration législative de la théorie de l’apparence
en matière de fiducie. En effet, il découle de cet article que le fiduciaire
sera réputé propriétaire
absolu à l’égard
des tiers. Or, la « réputation » se forge à partir d’éléments
apparents et non nécessairement réels. C’est donc admettre que le tiers
acquéreur sera toujours admis à se prévaloir de l’apparence de propriétaire que
revêt le fiduciaire. Cette disposition vient faciliter le travail du tiers
quant à prouver les circonstances qui l’ont amené à croire en l’apparence de
propriétaire du fiduciaire. Nous y reviendrons dans les développements
ultérieurs.
Nous avons
identifié les difficultés susceptibles de mettre à mal l’efficacité de la
fiducie-sûreté entre les parties et à l’égard des tiers. Il convient à présent
de les résoudre.
La solution tirée le la publicité du contrat
Si l’ignorance du contrat et de ses incidences
sur la qualité des parties par le tiers
a pu être vecteur de cette inefficacité, il faut dès lors trouver la solution
dans le moyen d’assurer la connaissance de ce contrat par le tiers, c’est à
dire dans le moyen d’assurer sa publicité. Ainsi, le contrat pourra devenir
efficace à l’égard des tiers, en d’autres termes, il sera opposable aux tiers.
De quels moyens
dispose-t-on en pratique ? Sont-ils applicables à la fiducie ?
Il faut partir de
le l’idée fondamentale, et exprimée au projet, que le contrat de fiducie
s’intègre dans un ordre juridique préexistant, dont elle devra préserver la
cohérence en se soumettant aux dispositions d’ordre public propres à la matière
concernée.
Il en résulte que
si la fiducie-sûreté emprunte aux régimes de diverses institutions,
négativement, elle devra se soumettre à l’ensemble de leurs règles,
positivement, elle pourra s’en inspirer.
En raison du
transfert de propriété qu’elle opère, la fiducie-sûreté va pouvoir emprunter
aux autres institutions translatives de propriété des solutions qui
garantissent l’efficacité de ces opérations.
Or, l’expérience
des diverses institutions translatives de propriété qui existent en droit
français nous enseigne que la publication du titre translatif de propriété sur
un registre à la Conservation des hypothèques est le système le plus efficace
pour assurer la publicité et partant, l’opposabilité de cet acte.
Ce système, qui est
celui de la publicité foncière,
n’existe néanmoins qu’en matière immobilière.
Nous limiterons
donc notre exposé au cadre de la fiducie-sûreté portant sur un immeuble, ce qui
n’est pas gênant, en soi, puisque c’est dans ce domaine que vont se poser le
plus de problèmes et que ces derniers auront des conséquences les plus graves.
Relativement à ce
qui se passe en matière de trust,
nous nous limitons à rappeler que les « droits » des trustee
et beneficiary feront l’objet de
mesures de publicité aptes à en assurer l’opposabilité. Nous nous référons à ce
que nous avons déjà dit sur ce point.
Revenons dès lors au problème plus controversé, on le verra, de la publicité de
la fiducie-sûreté.
La publicité du transfert de propriété
La publicité
foncière s’applique aux actes translatifs de propriété immobilière ou
constitutifs de droits réels immobiliers.
Dès lors, elle
concerne manifestement le contrat de fiducie-sûreté lequel opère le transfert
de la propriété d’un bien. Les parties devront accomplir les formalités de
publicité du contrat afin de rendre
opposable aux tiers le transfert de la propriété du bien, du constituant au
fiduciaire. Est ainsi
résolu le premier ordre de difficultés.
La question de la publicité de la qualité de fiduciaire
Le second ordre de
difficultés est plus délicat à résoudre. Il s’agit en effet d’assurer
l’opposabilité de la qualité de fiduciaire, c’est à dire d’assurer
l’opposabilité de l’affectation qui grève le droit de propriété du fiduciaire
et qui rend ce droit inaliénable aux tiers.
Cette considération est d’autant plus importante qu’en cas de litige sur ce
point, le tiers pourra se prévaloir de ce que le fiduciaire est « réputé
disposer des pouvoirs les plus étendus sur les biens et droits objet du
contrat. Il appartiendra à celui qui invoque la qualité de fiduciaire de
prouver que le tiers avait connaissance de la limitation de pouvoirs inhérente
à cette qualité.
L’identification du problème
Imaginons que le
fiduciaire, en sa qualité de propriétaire, aliène le bien cédé à titre de
garantie à un tiers acquéreur. Ce tiers acquéreur a valablement acquis la
propriété de ce bien puisque son auteur, le fiduciaire, est propriétaire. Ce
dernier aura simplement violé son obligation fiduciaire laquelle lui
interdisait d’aliéner le bien mis en fiducie.
En revanche, les
conséquences seront importantes pour le constituant-débiteur lequel ne pourra
récupérer, en nature,
la propriété de son bien. En effet, comme nous l’avons déjà vu, le constituant
ne bénéficie que d’un droit de créance à l’encontre du fiduciaire duquel il ne
peut qu’exiger le respect de ses obligations contractuelles. Contrairement au settlor-beneficiary d’un trust, notre bénéficiaire ne dispose pas
d’un droit réel sur le bien mis en fiducie, il ne peut donc pas suivre le bien
en les mains du tiers acquéreur.
Une solution tirée de la nature du droit du fiduciaire
Une solution
consiste à mentionner la qualité de fiduciaire que le propriétaire revêt
lorsque les parties accompliront les formalités de publicité relativement au
transfert de propriété réalisé par la fiducie-sûreté. Cette solution
informerait le potentiel acquéreur, désireux de se renseigner sur la situation
du bien immobilier, que ce dernier est affecté à un but particulier lequel rend
le bien inaliénable.
Admettre cette
solution, c’est considérer que l’obligation fiduciaire constitue une
restriction au droit de disposer. En effet, seules les restrictions au droit de
disposer sont sujettes à publication obligatoire.
Le projet en prend
acte puisqu’il dispose à l’article 2070 futur du code civil « Lorsque la
fiducie porte sur des droits et biens dont la mutation est soumise à publicité,
celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès-qualités. ».
Nous avons déjà eu
l’occasion de démontrer comment, à notre humble opinion, l’inaliénabilité des
biens composant le patrimoine fiduciaire, ainsi que l’obligation de les
rétrocéder sont des restrictions au droit de disposer.
Dès lors que cette
qualité de fiduciaire est publiée, elle est opposable aux tiers. Mais quelle
conséquence doit-on en tirer quant au sort du bien aliéné au tiers, lequel, en
dépit de l’opposabilité de la qualité du fiduciaire à son égard, n’en a pas
moins acquis, certes de mauvaise foi,
un droit de propriété. Fera-t-il retour au constituant ? Admettre cette
solution, c’est faire triompher le droit personnel du constituant sur le droit
réel du tiers acquéreur.
On peut
raisonnablement penser que le juge sera prêt à adopter cette solution en ce
qu’il l’a déjà admise en matière de promesse unilatérale de vente. Or, on l’a
vu le problème se pose dans des termes très proches en cette matière.
Le juge a eu
l’occasion de statuer en faveur d’un bénéficiaire d’une promesse unilatérale de
vente et aux dépens d’un tiers acquéreur de mauvaise foi:
avant que le bénéficiaire ne lève l’option dont il dispose de voir conclure la
vente à son avantage, le promettant décide de vendre le bien à un tiers et donc
en violation de la promesse; avant la levée de l’option, le bénéficiaire d’une
promesse unilatérale de vente n’est titulaire que d’un droit de créance; le
promettant demeure titulaire du droit de propriété, il est toujours en mesure, mais non en droit
de l’aliéner à un tiers à condition de supporter les conséquences de la
violation de la promesse; le tiers acquéreur, non soumis à la loi du contrat, a
pu valablement acquérir le droit de propriété.
En dépit du fait
que le bénéficiaire est simplement titulaire d’un droit de créance, le juge va
statuer en sa faveur et faire triompher ce simple droit de créance sur le droit
réel du bénéficiaire en ce que ce bénéficiaire était de mauvaise foi (ce
dernier avait connaissance de la promesse).
Cette solution est
transposable à notre hypothèse et sera d’autant plus facile à mettre en œuvre
que le tiers acquéreur en « violation » du contrat de fiducie sera
toujours présumé de mauvaise foi.
Surtout, cette
solution semble à même d’assurer l’efficacité du contrat de fiducie-sûreté à
l’égard des tiers. Mais on peut adresser une critique à cette solution,
critique qui nous amène à opter pour une autre solution.
Une solution incohérente au regard de la nature du droit de
propriété
Dire à notre tiers
acquéreur qu’il bien devenu propriétaire d’un bien, mais que son droit n’est
pas opposable au constituant qui n’a pourtant aucun droit direct sur ce bien,
procède d’une analyse artificielle, sinon même d’une contradiction dans les
termes. N’est-ce pas le propre du droit de propriété d’être opposable à tous ?
Cette opposabilité erga omnes est ce qui fonde le caractère
absolu du droit de propriété. La jurisprudence n’hésite donc pas à porter
atteinte au caractère absolu du droit de propriété, l’exemple le prouve, quand
les intérêts en cause le justifie. Il faut aller plus loin, éviter tout
artifice juridique
et tirer les conséquences théoriques de la situation à laquelle mène cette
solution. C’est ce que nous nous proposons de faire à présent.
Proposition de qualifications pour renouer avec la cohérence
Pour légitimer
notre démarche, partons de la solution à laquelle aboutit la position de la
jurisprudence. Elle consiste à attribuer le bien au bénéficiaire alors qu’une
autre personne, le tiers acquéreur, est détentrice du droit de propriété de ce
bien. Loin de nier au tiers acquéreur son droit sur la chose, elle reconnaît au
bénéficiaire un droit sur la chose encore plus fort puisqu’elle va jusqu’à le
préférer à celui du tiers acquéreur. Maintenir que le bénéficiaire n’est
titulaire que d’un droit de créance, c’est confiner à un paradoxe digne de
Zénon d’Elée !
Il est temps de
reconnaître que le bénéficiaire de la fiducie-sûreté est titulaire d’un droit
relatif à la chose en ce qu’il confère à son titulaire un véritable pouvoir sur
la chose. Son droit fonde l’obligation du fiduciaire qui n’existe qu’à cause de
la chose. C’est une obligation propter rem et son corollaire est le droit du bénéficiaire, droit à exiger
l’inaliénabilité de la chose, droit à exiger le transfert de la chose à son
unique profit. Ce droit que l’on a pu qualifier, sans doute par prudence ou
timidité, « droit personnel d’affectation »,
est un droit réel d’un genre particulier. Nous le qualifierons de ius
ad rem, qualification certes peu parlante - qui le deviendra avec
l’étude de son régime
- mais dont le choix, loin d’être
anodin, se justifie, en autres, par le fait qu’elle est utilisée, par certains
auteurs anglais, pour qualifier le droit du beneficiary d’un trust.
Certes,
pourriez-vous objecter, le droit de notre bénéficiaire ressemble bien à celui
du beneficiary lorsque tout va bien,
mais commence à se dissembler nettement dès qu’il s’agit de le mettre en œuvre.
Cela est vrai, et nous le verrons bientôt.
Mais nous verrons aussi que derrière cette vérité se cachent nombre
d’illogismes et paradoxes, lesquels s’extériorisent à travers les règles du
régime de la fiducie-sûreté. C’est précisément pour cette raison que nous
choisissons de qualifier le droit du bénéficiaire de ius ad rem, car comme tout un chacun sait, de la qualification
d’une opération va dépendre le régime juridique.
Qualifier le droit
du bénéficiaire de ius ad rem, c’est
s’engager à en tirer les conséquences juridiques. Le projet ne l’a pas fait.
Nous devrons respecter ce choix lors de l’étude du régime de la fiducie-sûreté.
Mais devant les solutions absurdes
auxquelles l’application de ce régime risque d’aboutir, nous nous efforcerons
de proposer des solutions auxquelles les qualifications de ius ad rem, quant au droit du bénéficiaire, d’ obligation propter rem
quant à l’obligation fiduciaire nous permettent d’aboutir.
Avant de conclure notre
premier titre et nous intéresser au régime de la fiducie-sûreté, nous devons
faire état d’un dernier phénomène susceptible de mettre à mal l’efficacité de
la fiducie-sûreté, en dépit de l’accomplissement de toutes les précautions
susmentionnées.
La question de la licéité de la fiducie-sûreté
Il subsiste un
moyen de canaliser le contrat. Il consiste à faire preuve de sévérité dans
l’examen de sa licéité au regard, selon les termes mêmes de l’article 2062
alinéa 2, « des dispositions d’ordre public propres à la matière
concernée » par la fiducie, en d’autres termes, au regard des règles
impératives du droit des sûretés.
On songe à la
prohibition du pacte commissoire
et de la clause de la voie parée.
Le pacte
commissoire est celui qui permet au créancier de s’approprier le bien servant
de garantie en cas de défaillance du débiteur, sans le faire auparavant
attribuer par décision de justice.
Par la stipulation
d’une clause de voie parée, le créancier peut vendre à l’amiable le bien objet
de la garantie afin de se payer sur le prix obtenu.
En effet, le fiduciaire-propriétaire va pouvoir, si le débiteur ne paie pas sa
dette, vendre le bien pour se désintéresser sur le prix obtenu, sous réserve
que le contrat de fiducie n’en dispose pas autrement. Les rédacteurs du projet
admettent implicitement la stipulation d’une telle clause dans une fiducie.
Toutefois, ils prennent garde d’assurer un minimum de sécurité au débiteur
contre un risque de spoliation en prévoyant une détermination de la valeur du
bien à dire d’expert ou en fonction de leur côte sur un marché organisé s’il
s’agit de contrats ou valeurs mobilières.
Ainsi, ces
prohibitions ne devraient pas jouer lorsque la fiducie porte sur des biens dont
l’évaluation ne pose pas de difficulté. Tel n’est pas le cas, en revanche, des
meubles corporels du type biens d’équipement.
Relativement à
l’interdiction du pacte commissoire, il semble que l’on a prêté à cette règle
une portée qu’elle n’a pas: on sait que la prohibition ne joue pas si le pacte
intervient après la constitution du nantissement; c’est le cas dans notre
espèce puisque le contrat de fiducie-sûreté prévoit la rétrocession du bien,
c’est même une obligation; ce n’est que dans une circonstance non prévue au
contrat (défaillance du débiteur), que sera mis en œuvre, comme mode de
résolution du conflit que créée la circonstance, un mécanisme équivalent au
pacte commissoire.
En outre, ces
prohibitions ne sont pas posées par la loi de manière générale, elles le sont
uniquement dans le cadre de sûretés nommées (gage et antichrèse). En résulte
d’ailleurs un certain embarras en jurisprudence. D’une part, les juges
n’hésitent pas, en présence de ventes à des fins de garantie, à qualifier ces
contrats de prêts avec pacte commissoire prohibé et ce, pour annuler l’ensemble
de l’opération. Mais d’autre part, ces pactes n’étant pas prohibés pour toutes
les sûretés, la Cour de Cassation en a tiré la conséquence suivante en matière
d’hypothèque: la prohibition du pacte commissoire ne joue pas pour cette sûreté.
Enfin, force est de
constater qu’aujourd’hui, la jurisprudence a considérablement entamé la
prohibition du pacte commissoire, comme en atteste la lecture d’arrêts récents
de la Cour de Cassation, et dont l’intérêt pour notre étude, justifie que l’on
s’y attarde.
Par un arrêt du 17
mai 1994, la Cour
de Cassation écartait implicitement le reproche de pacte commissoire prohibé en
confirmant l’arrêt d’appel qui a recouru à la compensation de plein droit qui
s’opère entre créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur
exigibilité et à leur montant. La Cour de Cassation précise dans sa motivation
« dès l’instant de leur remise, les sommes déposées à titre de garantie de
l’exécution de ses obligations, par le locataire gérant, sont devenues, en raison
de leur nature fongible la propriété (du bailleur) ».
En effet, lorsque
le bien remis en garantie est constitué d’espèces, on comprend que les
procédures d’évaluation soient inutiles puisque la valeur de ce bien ne
s’exprime que dans la quantité dont il est la référence.
Dans une seconde
affaire où il y avait eu remise de sommes d’argent entre les mains de la
banque, sur un compte bloqué, et pacte commissoire, la Cour de Cassation, dans
un arrêt du 9 avril 1996,
l’analyse de la cour d’appel selon laquelle « n’est pas prohibée par
l’article 2078 du Code Civil la stipulation d’attribution d’un gage, constitué
en espèces, par le créancier à due concurrence du défaut de paiement à
échéances ».
Depuis l’arrêt du
17 mai 1994 qu’il commentait, le Professeur Larroumet
critiquait la terminologie de « gage-espèces », car il n’y a, dans
l’opération de remise des fonds, aucun caractère du gage. Il fallait donc
parler de fiducie ou de fiducie sûreté et il répétait cette critique dans son
commentaire de l’arrêt du 9 avril 1996
en disant que si la solution devait être approuvée, la motivation en était
critiquable parce qu’il s’agit, finalement de toute
« fiducie-sûreté ». Il ajoutait : « même si celle-ci a pour
objet un corps certain ».
Loin de se
contenter du mécanisme de la compensation ou de l’inadaptation de la
prohibition de l’article 2078 du Code civil, la Cour de Cassation a
manifestement voulu encore innover : dans un arrêt du 3 juin 1997,
la Cour de Cassation confirme que la créance d’une banque qui avait reçu un
« gage-espèces » s’est éteinte par compensation avec l’obligation
qu’elle aurait eu de restituer les fonds dont la propriété lui avait été
transférée en garantie. Ainsi la Cour de Cassation confirme-t-elle que les
sommes remises à la banque étaient devenues sa propriété dès la remise, et la
compensation qu’elle admet est celle de la créance certaine et exigible de la
banque avec non pas une dette de somme d’argent mais une obligation de
restituer le gage.
Selon la Cour de
Cassation, la banque peut compenser sa dette de restitution des sommes données
en gage, avec sa créance exigible. Or, force est de constater que la banque
n’avait pas l’obligation exigible de restituer (ou du moins pas encore, car, si
on est bien dans le régime classique du gage, elle continuait d’exercer le
droit de rétention aussi longtemps qu’elle n’était pas payée).
La Cour de
Cassation ne fait plus aucune référence à la fongibilité ou à la
consomptibilité pour rappeler que les sommes transférées l’ont été en pleine
propriété à titre de garantie.
Ainsi, la propriété
du bien remis est acquise ab initio
au créancier, elle est assortie d’une obligation de restituer si tout se passe
bien entre le débiteur et le créancier, et elle est pérenne et acquise pour
toujours si le débiteur ne s’exécute pas.
La Cour de
Cassation estime donc que, sur le principe, le pacte commissoire n’est pas
prohibé. En voulant passer par le raisonnement du transfert de propriété
initial, la Cour de Cassation instaure la légitimité prétorienne de la
fiducie-sûreté.
La Cour de
Cassation, à son tour, semble prête à accueillir l’institution de la
fiducie-sûreté, attitude qui vient conforter l’intérêt actuel que présente
l’étude de cette institution. Dès lors ne saurait-on s’arrêter à l’étude
statique de la fiducie-sûreté.
Militant pour la
renaissance de la fiducie-sûreté, nous nous devons de l’étudier à présent sous
son angle dynamique, alors que, une fois constituée, ’il s’agit de l’exécuter.
Or, exécuter la
fiducie-sûreté, c’est appeler à contribution les règles qui régissent son
fonctionnement, c’est s’intéresser à son régime. Tel est l’objet du second
titre de notre étude.
Exposer le régime
juridique d’une institution, c’est s’inspirer de la qualification de celle-ci.
De cette qualification en découle le régime. Cela paraît simple. Pourtant, deux
travers existent. Attribuer à une opération une qualification erronée dans le
seul but de lui en appliquer le régime. C’est le premier travers.
Le second travers, et c’est celui du projet, consiste à ne pas tirer les
conséquences des qualifications retenues, ou simplement à ne pas en tirer du
tout. Il en résulte un régime incohérent et incomplet. Nous refusons de nous y
soumettre. Aussi, nous choisissons de présenter un régime juridique de la
fiducie-sûreté en retenant ce qu’il y a de bon dans le projet, et en
complétant, dans la mesure du possible,
avec des solutions empruntées à d’autres régimes juridiques, principalement au trust.
Le régime de la
fiducie-sûreté vient régler deux phases importantes de la vie de celle-ci: son
exécution lors de son existence, son dénouement à son extinction. Dès lors, il
nous appartiendra de présenter successivement les règles régissant l’exécution
de la fiducie-sûreté, puis les règles régissant son dénouement. Mais avant
toute chose, nous devrons préciser comment la fiducie-sûreté, dès l’instant où
elle devient effective, passe d’une
phase à l’autre, ie de l’exécution au
dénouement. Le chapitre préliminaire s’y consacre.
La vie de la
fiducie-sûreté intéresse au premier abord ses géniteurs, à savoir les
participants à sa conception - nous avons nommé « les parties ». Son
entrée dans la société va nécessairement impliquer sa confrontation à des
étrangers - nous avons nommé « les tiers » - lesquels pourront, de
près ou de loin, s’y intéresser. Les rapports que la fiducie-sûreté liera avec
ces deux groupes d’individus seront naturellement différents - ses géniteurs
l’ont voulu alors qu’elle s’impose à la société.
Ce constat justifie
que l’on choisisse de s’intéresser en premier lieu aux effets de la
fiducie-sûreté entre les parties, ce sera l’objet d’un premier chapitre et un
second chapitre sera, sans surprise, consacré aux effets de celle-ci à l’égard
des tiers.
S’intéresser à
l’exécution de la fiducie-sûreté, c’est se situer dans la phase de son
existence. Considérer le dénouement de la fiducie-sûreté, c’est se placer dans
la phase qui débute avec son extinction.
L’exécution de la fiducie-sûreté
Dès lors que la
fiducie-sûreté a valablement été créée, elle existe. Il s’ensuit que chacune
des parties va pouvoir exiger de son cocontractant le respect des obligations
auxquelles il s’est engagé en entrant dans les liens du contrat.
L’exécution du
contrat de fiducie-sûreté tendra à ce que le bien qui a été transféré au
fiduciaire, à titre de garantie du paiement de la dette par le constituant, son
débiteur, soit affecté à cette utilisation.
Il en découle des
obligations à charge du fiduciaire car c’est à lui que le constituant a confié
ses biens afin qu’il les conserve à titre de garantie et les lui rétrocède
quand ce dernier aura payé sa dette.
Le « propriétaire »-fiduciaire
est tenu d’«obligations » corrélatives à ses « pouvoirs » sur le
bien qu’il tient en propriété
Voilà une belle
combinaison atypique digne d’un trust
! Il peut paraître paradoxal de parler d’ « obligation » alors que les deux parties sont, par
définition, liées par un rapport de confiance. C’est peut-être la raison qui
préside, dans le projet, le choix du terme « mission » pour parler
des obligations du fiduciaire.
Ou peut-être que les rédacteurs éprouvent une gêne à imposer des « obligations »
relatives à un bien dont il est pourtant propriétaire. Il faut donc voir ici
une volonté des rédacteurs de privilégier la qualité de propriétaire
(sous-entendu « absolu ») du bien.
Mais la suite de la disposition ne peut que nous ravir en ce qu’elle exige que
le contrat définisse « l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition; ».
N’y a-t-il pas, en
droit français, redondance, si ce n’est pléonasme, à attribuer à une personne
la qualité de propriétaire d’un bien et à lui conférer parallèlement des
pouvoirs d’administration et de disposition sur ce même bien, pouvoirs que sa
qualité de propriétaire lui confère déjà.
Faut-il dès lors comprendre que le droit de propriété qu’on a voulu attribuer
au fiduciaire n’est pas absolu , ou bien même qu’on ne souhaitait lui conférer
qu’un droit réel résiduel.
Nous n’irons pas jusque là afin de préserver le sens de la définition de la
fiducie adoptée par le projet.
A tout le moins
peut-on déceler, à travers cette disposition, la manifestation de l’idée selon
laquelle le fiduciaire se voit conférer, par sa qualité de propriétaire, plus
de pouvoirs que n’en nécessite la constitution d’une sûreté.
On peut néanmoins
considérer avec intérêt l’utilisation par le projet du terme
« pouvoir ». Le pouvoir est « une prérogative permettant à une
personne (...) de gérer les biens d’une
autre personne pour le compte de celle-ci ».
Le mandataire en est l’exemple même: il
détient le « pouvoir de faire
quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Le pouvoir est comme le droit subjectif une prérogative mais à la différence
essentielle que le pouvoir permet à celui qui le détient d’exprimer un intérêt
au moins partiellement distinct du sien, au moyen d’actes juridiques ayant
pour effet d’engager autrui.
En outre, admettre
que le fiduciaire exerce une mission pour laquelle il dispose non pas de droits
mais de pouvoirs, c’est se rapprocher de la conception anglaise du
« droit » de propriété : le common
law associe titre et pouvoir et non titre et droit subjectif. Nous nous
sommes déjà expliqués sur ce point, nous n’y revenons pas.
Le fiduciaire n’a pas à rendre
compte de l’exercice de son droit subjectif
Admettre que le
fiduciaire détient un pouvoir et non un droit aurait l’avantage de permettre un
contrôle par le juge ou une autre instance formée à cet effet, lesquels joueraient pour la fiducie le rôle
que le juge anglais joue pour le trust.
En effet, le projet
ne prévoit aucune sorte de contrôle sur l’exercice de ses
« pouvoirs » par le fiduciaire, la seule intervention judiciaire
prévue se situant à un stade où il est déjà trop tard.
La raison en est que le projet opte délibérément pour la qualité de
propriétaire du fiduciaire. Or, le contrôle de l’exercice d’un droit subjectif
tel que le droit de propriété n’est pas concevable en droit français.
En revanche,
admettre que le fiduciaire, à l’image du trustee,
ne dispose que de pouvoirs pour l’accomplissement de sa mission, c’est ouvrir
la possibilité d’une sanction du fiduciaire lequel utiliserait à mauvais
escient les pouvoirs qui lui ont été conférés, sanction qui pourrait être celle
du détournement de pouvoirs
telle qu’on la connaît en droit public.
Enfin pourrait-on
lui imposer de rendre des comptes au constituant comme on l’exige au mandataire
à l’égard du mandant, solution qui rapprocherait encore la fiducie du trust. En effet, le law of trusts impose au trustee
de tenir des comptes de sa gestion et d’informer régulièrement les
bénéficiaires (duty to account);
certes une telle obligation présente moins d’intérêt en matière de
fiducie-sûreté qu’en matière de fiducie-gestion.
En effet, le
fiduciaire-propriétaire n’a pas la possession du bien, il n’a donc pas à
s’occuper de sa maintenance par exemple, mais n’oublions pas que sa qualité de
propriétaire va faire peser les risques de la propriété sur ses épaules.
Dès lors, il devra
assumer les conséquences de la perte de la chose avant la rétrocession de la
propriété au constituant, à condition bien sûr que la perte de la chose ne soit
pas imputable à son possesseur le constituant.
Ainsi, un
fiduciaire prévenant pourrait vouloir s ’assurer contre les conséquences
de la perte de la chose; à cet effet, il conclura un contrat d’assurance
relatif à la chose dont il pourra se rembourser les frais en se payant sur le
patrimoine fiduciaire. Une telle possibilité n’est envisageable qu’à condition
que ce dernier fasse une reddition des comptes au constituant. Le projet
n’impose pas une telle obligation au fiduciaire car il le traite avant tout en
sa qualité de propriétaire.
L’obligation de loyauté du
fiduciaire
La principale
obligation qui pèse sur le fiduciaire est d’ «exercer sa mission dans le
respect de la confiance du constituant. » .
Elle est la résurrection de l’uberrima
fides dont les juristes romains avaient exprimé le devoir de respect dans
un certain nombre d’opérations où les contractants sont captifs l’un de
l’autre. Cette obligation de loyauté met en valeur le caractère fortement intuitu personae de ce contrat dont le
projet a fait une pétition de principe.
La question qui se
pose ici est relative au contenu de cette obligation. Le projet est muet sur ce
point. La solution se trouve peut-être dans la suite de la disposition qui
envisage l’hypothèse de la responsabilité du fiduciaire si ce dernier
« manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont
confiés ». En effet, la mise en péril des intérêts confiés ne résultera
pas forcément d’un manquement à ses devoirs, elle pourrait résulter de
l’utilisation conforme de ses pouvoirs mais de manière à en retirer un profit
personnel. Dès lors que le fiduciaire a en vue un intérêt personnel lorsqu’il
exerce ses pouvoirs, il n’agit plus totalement dans le but de la fiducie, il
met en péril les intérêts confiés. La difficulté sera, pour le praticien, de
tracer les contours de cette obligation dont le projet ne donne qu’un cadre
général.
Une obligation floue, instrument
potentiel de protection du débiteur-constituant
Le caractère flou de cette obligation risque d’en
faire une sorte d’obligation - «fourre-tout »
laquelle pourrait être utilisée comme moyen de protection du
débiteur-constituant contre le fiduciaire défaillant. Par son biais, le juge
désireux, de protéger un constituant manifestement lésé mais impuissant à
reprocher un manquement du fiduciaire à ses devoirs tels qu’expressément
déterminés au contrat, se prêterait à
des interprétations divinatoires de la volonté des parties afin de gonfler le
contenu de cette obligation.
On peut
raisonnablement prévoir une telle pente en raison de l’attitude contemporaine
du juge qui tend à protéger certaines parties mises en position de faiblesse
car dominées économiquement par leurs cocontractants au sein d’opérations pour
elles indispensables.
Or, dans l’opération
de fiducie-sûreté, le constituant-débiteur en besoin imminent de crédit sera
souvent conciliant avec son créancier lequel pourra imposer ses conditions sine qua non, au point qu’il deviendra
difficile de considérer le contrat comme un contrat de négocié.
Ce constat pourrait
mener le juge à y voir un contrat d’adhésion, aussi pourrait-il être amené à y
déceler une clause abusive.
Bref, la fiducie-sûreté se placerait à côté de nombreux autres contrats sous la
coupelle du droit de la consommation. Nous n’en sommes pas là.
Si le projet
reporte manifestement sur le juge la tâche de préciser le contenu de cette
obligation, on ne saurait qu’inviter ce dernier à s’inspirer des fiduciary duties dégagés par le juge
anglais de cette exigence de loyauté.
Une obligation dont le contenu
pourrait s’inspirer des fiduciary duties imposés au trustee
La principale
obligation qui pèse sur le trustee
lui impose de remplir avec diligence les
buts du trust.
Si la jurisprudence
française retient ce degré d’exigence relativement au résultat à atteindre
quant à exécution de l’obligation de loyauté qui incombe au fiduciaire, on
pourrait raisonnablement en conclure
qu’il s’agit là d’une obligation de
moyens.
Il en résulterait,
pour le constituant qui invoque une violation de cette obligation par le
fiduciaire, la charge de prouver que ce fiduciaire n’a pas agi avec diligence
dans l’accomplissement de sa mission. La solution serait bonne car elle
s’inscrirait dans la lignée du régime de l’obligation de bonne foi;
or cela semble logique que l’obligation particulière de loyauté qui peut
s’entendre comme l’obligation d’observer sur sa foi la loi du contrat, suive le
régime de l’obligation générale de bonne foi, de laquelle elle découlerait en
quelque sorte.
De cette
obligation, il découle que le trustee,
s’il entre en spéculation dans l’intérêt du trust,
doit s’en tenir à des actes de spéculation raisonnables.
En matière de
fiducie-sûreté, on pourrait ainsi imaginer la situation suivante: une personne
devient fiduciaire et du même coup propriétaire d’un local commercial cédé en
garantie du remboursement par le constituant, son débiteur, de sa dette; le
fiduciaire et le constituant décident de louer ce local
afin d’en tirer profit, sachant que l’attribution du profit a été convenue
entre les parties;
il serait déloyal de la part du fiduciaire de louer ce local à un ami et de
convenir d’un loyer de faveur. De plus, cela ne profiterait en rien au
constituant.
Or, ce profit pour
le constituant est la condition d’une autre obligation du fiduciaire,
corollaire de la précédente, on le voit, ce est parfaitement logique
puisqu’elles découlent de la même obligation principale, l’obligation de
loyauté.
Le trustee a le devoir de protéger
l’intérêt du bénéficiaire
auquel profite le trust. Toute
l’action du trustee est régie par
l ’acte de trust et doit être
inspirée par lui.
Ainsi notre
fiduciaire aurait le devoir d’agir dans
l’intérêt du constituant . Cela vient encore prêcher en faveur de l’idée selon
laquelle le fiduciaire ne dispose pas d’un droit mais de pouvoirs en ce qu’il
utilise sa prérogative dans l’intérêt d’autrui.
En matière de
sûreté, ce devoir se traduira par l’
obligation de ne pas aliéner le bien cédé à titre de garantie.
En effet, aliéner
le bien en dehors du cas où le contrat le prévoit, consistera à agir dans un
intérêt personnel ou dans l’intérêt de tiers et non dans celui du constituant.
Cette obligation qui pèse sur le trustee
pèse de la même manière sur le fiduciaire. Aussi, il est intéressant de
s’arrêter sur le devoir de ne retirer
aucun profit personnel de la conservation du bien dont cette obligation
découle directement.
Cette obligation
qui pesait déjà sur le fiduciaire de la ficucia
cum creditore justifiait qu’il ne perçoive aucune rémunération. Mais nous savons qu’à l’heure actuelle, tout
service se paie. ainsi, si Pothier voyait dans le mandat « un pur office
d’amitié »,
la professionnalisation des affaires a vu naître le mandat salarié. De la même
manière, on a pu admettre progressivement une rémunération du trustee mais le montant de celle-ci est
réglementé avec précision. Il faut noter que les common lawyers apprécient plus sévèrement les obligations du trustee rémunéré que s’il ne l’était
point. Cette solution est facilement transposable en droit français d’autant
plus qu’elle est retenue en matière de mandat.
Nous devons
néanmoins émettre une réserve quant à l’utilité de cette solution en matière de
fiducie. La renaissance tardive de la fiducie ne permettra sans doute pas d’en
retrouver son caractère originellement gratuit. aussi peut-on prévoir que la
rémunération du fiduciaire sera le principe et la gratuité l’exception. Pour
adapter utilement la solution ci-dessus exposée en matière de fiducie, on
pourrait renverser la proposition et poser que les obligations du fiduciaire
seront appréciées plus souplement lorsque la fiducie est gratuite.
Du devoir de ne
retirer aucun profit personnel, il découle que le trustee doit éviter tout
conflit d’intérêts entre ses intérêts propres et le but du trust. Il est intéressant de noter à cet
égard que les devoirs du trustee
commencent avant même qu’il ait accepté ses fonctions puisque, s’il découvre
dans celles-ci une cause de conflit avec ses propres intérêts, il doit y renoncer.
Cette solution est
bonne car elle évite dès le début que la constitution d’un trust fondé sur un rapport de confiance illusoire. On devrait
transposer cette solution en matière de fiducie-sûreté.
Il en découlerait
par exemple qu’une personne ne saurait se porter fiduciaire d’un bien alors
qu’elle avait, préalablement à la constitution de la fiducie, manifesté
l’intention de l’acquérir. On pourrait alors suspecter cette personne d’avoir
conclu ce contrat comme moyen d’acquérir indirectement un bien qu’elle ne
pouvait directement acquérir faute d’intention de son propriétaire d’en
transférer définitivement la propriété.
Or la fiducie
revient à opérer un transfert temporaire de la propriété.
D’une part, le
contrat serait nul pour absence de cause
ou cause illicite
ou tout simplement absence de consentement.
D’autre part, il y
aurait violation de l’obligation de loyauté avant même que le respect de
celle-ci soit exigible
!
Aussi, le fiduciaire
qui retire un profit personnel de ses fonctions, autre que sa rémunération,
devrait restituer ce qu’elle a reçu, tout profit devant retomber dans le
patrimoine fiduciaire. Si la solution semble aller de soi, des difficultés
quant à sa mise en œuvre vont se poser en droit français, nous y reviendrons
lors de l’examen des effets de la fiducie entre les parties.
La loyauté se délègue !?
Cette remarque peut
sembler paradoxale dès lors qu’on se souvient que cette obligation de loyauté
répond à la confiance que le constituant a placée dans une personne, laquelle
en acceptant la qualité de fiduciaire se soumet du même coup à cette
obligation.
Dès lors, il paraît
difficilement concevable que le fiduciaire, choisi intuitu personae, puisse déléguer ses fonctions. L’equity prît acte de cette considération
en posant la règle delegatus non potest
delegare. Il en résultait que le trustee
ne pouvait pas transférer ses devoirs ou ses obligations à d’autres personnes.
Mais une réalité
est peu à peu devenue évidence: le fiduciaire, lequel avait accepté une mission
très générale, laquelle impliquait parfois de passer des actes, de prendre des
décisions dans les domaines les plus variés, ne se révélait pas toujours à la
hauteur; il était dès lors dans intérêt du trust
que le trustee, s’estimant d’une
compétence insuffisante pour mesurer l’intérêt d’un acte relativement au trust,
délègue certains de ses pouvoirs.
Au regard de cette
seconde considération, le judge-made law,
suivi par le lawmaker,
ont admis de « véritables » exceptions au principe de
l’interdiction de la délégation de pouvoirs du trustee. Ces exceptions sont venues assouplir d’avantage une
institution déjà souple en soi. Nous insistons sur le caractère véritable de
ces exceptions afin de mettre en exergue que celle qui semble avoir été admise
par le projet concernant la fiducie n’est qu’apparente.
Ainsi est-il admis
que le trustee délègue l’ensemble de
ses pouvoirs pour une durée maximale de douze mois mais il sera plus fréquent
que le trustee recourt à un
mandataire pour accomplir un acte déterminé. Seule la dernière possibilité est
admise par le projet. Nous considérons de telles possibilités comme de
véritables exceptions au principe sus-énoncé en ce que, dès lors que le trustee aura choisi son
« représentant » de bonne foi, le
trustee ne sera pas responsable
des dommages dus à la faute ou à la négligence de celui-ci.
La délégation est véritable puisque, dans le cadre de sa délégation, le
représentant agit aux lieu et place du trustee,
la responsabilité du trustee n’est
pas substituée à celle du représentant.
Il en va
différemment en matière de fiducie puisque l’article 2067 futur du code civil
pose que « le fiduciaire doit exécuter personnellement sa mission.
Toutefois, il peut déléguer l’accomplissement de certains actes à une personne restant sous son contrôle et sa
responsabilité ».
Ainsi, le projet,
par le premier segment de la disposition, vient consacrer le principe de
l’interdiction de la délégation les pouvoirs du fiduciaire.
Dans le second
segment, il prend acte des dérogations qui seront apportées à ce principe par
la pratique et en prévoit les conséquences en cas de difficultés, mais il n’en
consacre nullement une véritable exception.
Cette disposition a
le mérite de reprendre la solution adoptée en matière de mandat, attitude qu’on
ne peut qu’avaliser étant donnée la similitude des situations du fiduciaire et
du mandataire, lesquels ont l’un et l’autre été choisi intuitu personae pour l’exercice de leur mission.
En revanche, nous
manifestons une préférence pour la solution retenue en common law en ce qu’elle nous paraît mieux correspondre à la
réalité : certes la solution française a le mérite de se conformer au principe
posé « le fiduciaire doit exécuter personnellement sa mission »; mais
c’est encore au dessus qu’il faut se placer pour identifier le travers de la
solution. Ce principe découle du caractère intuitu
personae de la fiducie, c’est à ce niveau que se situe le problème.
Force est de
reconnaître qu’aujourd’hui, il est assez illusoire de parler de contrat intuitu personae, s’agissant de la fiducie-sûreté, quand on se
doute que le choix du fiduciaire sera en réalité guidé par des considérations
souvent étrangères à sa personne. Le débiteur n’aura en réalité pas le choix
puisque son fiduciaire s’impose de lui-même, il s’agira de son créancier.
Or il n’aura pas
non plus véritablement choisi son créancier intuitu
personae mais, par exemple, en considération des conditions que ce dernier
proposait quant à l’échelonnement des versements relatif au remboursement de la
somme créditée. Faute d’être véritablement
un contrat intuitu personae,
le principe ci-dessus exposé et qui en découle ne devrait pas avoir à
s’appliquer en matière de fiducie-sûreté. Il le sera en application de
l’article 2067 futur du code civil.
Faudra-t-il pour
autant se résigner devant une application sans fondement pertinent de cet
article ? Nous ne le pensons pas car, rappelons-le, le régime tel qu’exposé par
le projet est applicable à la fiducie quelle qu’en soit son utilisation, il est
un régime général qui ne prend pas en considération les particularités de
chaque utilisation particulière du contrat.
Ainsi, cette
absence d’intuitu personae est
particulière à la fiducie-sûreté, elle le sera dans certains cas de
fiducie-gestion mais elle ne se retrouve pas dans la fiducie-libéralité.
Cette remarque nous
conduit à espérer que la jurisprudence, au cours d’un litige soulevant la
question de l’application de l’article 2067, tirera les conséquences des
particularités propres à chaque utilisation de la fiducie, particularités qui
justifieront une application différenciée des règles de la fiducie en fonction
de son utilisation.
Aussi, pour
conclure sur ce point, on peut espérer que le juge, en présence d’une
fiducie-sûreté, n’hésitera pas à écarter l’application de cet article afin de
retenir la responsabilité du représentant du fiduciaire, lorsque certaines
conditions seront remplies.
Cette question nous
a amené à évoquer les pouvoirs du trustee
et du fiduciaire. C’est sur ces derniers que se fixe notre attention à présent.
Le fiduciaire dispose de pouvoirs
pour l’accomplissement de sa mission
Le fiduciaire
dispose des pouvoirs d’administration et de disposition dont l’étendue doit
être déterminée par le contrat de fiducie. Ces pouvoirs ne sont pas la
contrepartie de ses obligations. Ce sont des prérogatives qui lui permettent de
réaliser les buts de la fiducie. Ils découlent du fait que le fiduciaire est le
propriétaire des biens du trust. Il
est assez étonnant de remarquer que ce que nous venons de dire jusque là est
parfaitement transposable au trust.
C’est mettre en relief la similitude de leur situation.
En effet, comme
nous l’avons mentionné précédemment, outre la seule mention de la qualité de
propriétaire dans la définition de la fiducie, le reste du projet se réfère à
un fiduciaire titulaire de pouvoirs plutôt que de droits sur les biens placés
en fiducie, ou à tout le moins, semble lui accorder un droit réel résiduel sur
ces biens, droit qui ne lui permet pas d’aliéner librement ces biens à autrui.
Cette interdiction
va permettre la rétrocession des biens lors du dénouement de la fiducie.
Avant d’en arriver
à cette phase qui est celle de l’extinction de la fiducie-sûreté, voyons
comment l’exécution de la fiducie se déroule du côté du constituant.
Le constituant n’est pas obligé
par la fiducie-sûreté
Durant l’exécution
de la fiducie-sûreté, le constituant est tenu au paiement de sa dette mais
cette obligation ne résulte pas du contrat de fiducie-sûreté mais du contrat de
base auquel il vient se greffer. Il s’agit là de la seule action positive qui
sera exigée du constituant au cours de l’exécution de la fiducie-sûreté.
Si le constituant
transfère la propriété d’un bien à titre de garantie, il ne s’agit pas d’une
obligation de donner qui pèserait sur le constituant mais d’un effet
automatique du contrat qui aura lieu concomitamment à la conclusion du contrat
et non lors de son exécution. Nous avons déjà eu l’occasion de le montrer, nous
n’y revenons pas.
Il peut paraître
étrange de mentionner, dans le cadre de l’étude du régime d’un contrat, une
obligation à laquelle est certes tenu une partie à ce contrat mais laquelle
obligation est née d’un autre contrat. C’est que ce remboursement aura une
incidence lors du dénouement de la fiducie.
La fiducie-sûreté
prendra acte de l’action positive du constituant pour entrer dans la seconde
phase de son existence et s’éteindre.
Le régime de la
fiducie-sûreté s’étend au delà de son extinction puisqu’il va régler, comme le
ferait un testament d’une personne, les
conséquences de son extinction. Poursuivons la métaphore.
De la même manière
que le décès d’une personne provoque la dissolution de son patrimoine,
l’extinction de la fiducie-sûreté va provoquer la
« dissolution » du patrimoine fiduciaire; cette phase est celle
du dénouement de la fiducie-sûreté. Nous y consacrerons quelques développements
au cours de l’examen des effets de la fiducie-sûreté mais avant de s’y plonger,
il convient d’exposer une fois pour toutes les causes d’extinction de la
fiducie-sûreté.
La garantie s’éteint lorsque son
existence n’a plus d’intérêt
Tel est le triste
sort de notre fiducie-sûreté. Mais il faut se rendre à l’évidence: elle a été
conçue à dessein. Et c’est justement ce dessein qui justifie son sort.
Soyons plus
concrets. La fiducie-sûreté a été conclue afin de garantir le remboursement
d’une dette. Une fois cette dette remboursée, la garantie n’a plus lieu de
jouer, elle s’éteint naturellement. En termes plus juridiques, la
fiducie-sûreté est venu se greffer à un contrat principal duquel elle est
l’accessoire; or, le remboursement de la dette met fin au contrat principal, et
donc, par voie de conséquence, au contrat accessoire, la fiducie-sûreté. Cette
conséquence est une application de la règle Accessorium
sequitur principale, l’accessoire suit le principal.
L’idée qui devrait
présider à la détermination des causes d’extinction de la fiducie-sûreté se
résume en quelques mots: la garantie s’éteint lorsqu’elle n’a plus lieu de
jouer. Ainsi, et d’une manière générale, les circonstances personnelles propres
au fiduciaire ne devraient avoir aucune incidence sur l’existence de la
fiducie.
Si telle est la
situation dans le law of trusts, le
projet de loi concernant la fiducie ne l’entend pas de la sorte. Voyons plus
précisément ce qu’il en est de part et d’autre de la Manche.
Le futur article
2070-10 du code civil énumère les divers événements qui mettent fin à la
fiducie. On peut distinguer deux catégories événements, les uns entraînant
l’extinction naturelle de la fiducie, les autres permettant une extinction
judiciaire de la fiducie.
La survenance du terme ou la
réalisation du but poursuivi mettent naturellement fin à la fiducie comme au trust
En matière de
fiducie-sûreté, ces deux événements seront souvent concomitants. En effet, le
terme de la fiducie sera souvent celui du contrat de base. Or, le but poursuivi
par la fiducie est de garantir le remboursement de la dette née de ce contrat
de base. En réalité, les parties au contrat de fiducie souhaitent ne pas avoir
à mettre en œuvre la garantie; cela signifierait, pour le constituant la perte
de son bien et pour le fiduciaire, la charge de mettre le bien en vente et de se
rembourser dessus. Bref, le but de la fiducie est en définitive d’assurer le
remboursement de la dette et on peut considérer ce but réalisé une fois la
dette remboursée. Ainsi, la réalisation du but de la fiducie sera concomitante
au terme convenu.
La fiducie prendra
fin naturellement, automatiquement, sans que l’intervention du juge soit
nécessaire. Cette fin naturelle met en exergue le fait que cet événement est la
cause naturelle d’extinction de la fiducie car, répétons-le, il est logique que
la garantie s’éteigne lorsqu’elle n’a plus lieu de jouer, ie une fois la dette remboursée.
Il faut noter
qu’elle peut prendre fin avant terme dès lors que le but poursuivi a été
réalisé. Le terme vient refléter le laps de temps estimé par les parties comme
nécessaire pour la réalisation du but de la fiducie, à savoir le remboursement
de la dette. Si le but est poursuivi avant terme, la période restante ne
présente plus aucun intérêt pour les parties, il semble donc conforme à la
volonté implicite des parties de ne pas en tenir compte et de mettre fin à la
fiducie.
Le law of trusts retient également cet
événement comme mettant fin au trust.
En revanche, dans les cas où le projet prévoit le prononcé judiciaire de la fin
de la fiducie, le law of trusts envisage un remplacement du trustee.
La fiducie est
« euthanasiée » quand le trust
voit juste son trustee se « réincarner »
La métaphore vous semblera
peut-être de mauvais goût, elle a au moins le mérite d’être parlante. En
présence de certaines circonstances, il pourra être demandé au juge de mettre
un terme à l’existence de la fiducie. Dans d’autres, le juge le fera
automatiquement sauf si les parties manifestent leur intention de voir se
poursuivre le contrat au cas de telles circonstances. Leur intention en ce sens
s’extériorisera soit par des stipulations dans le contrat prévoyant les
conditions dans lesquelles le contrat se poursuivra,
soit au moment où événement fatal se produit en demandant au juge de prendre
toutes les mesures permettant la poursuite du contrat.
Considérons les circonstances qui conduisent à l’extinction de la
fiducie-sûreté:
La fiducie-sûreté
prend fin lorsque se produisent des circonstances qui affectent la situation
personnelle du fiduciaire: l’article 2070-10 mentionne les cas de disparition
du fiduciaire, tantôt physique,
tantôt juridique lorsque le fiduciaire est une personne morale,
et de mise en liquidation judiciaire. S’il est vrai que, dans ces situations,
on peut douter de la capacité du fiduciaire à poursuivre sa mission, soit parce
qu’il a disparu, soit parce que sa situation financière laisse planer un doute
quant à ses compétences à exercer une fonction,
on ne voit pas en quoi ces circonstances devraient influer sur l’existence de
la fiducie-sûreté.
Relativement aux
cas de disparition du fiduciaire, personne physique, la solution s’explique par
sa qualité de partie au contrat. En effet, le droit commun des contrats pose
comme règle que la mort d’une des parties n’a pas en principe pour effet de
faire disparaître le contrat, mais il en va différemment dans le cas où le
contrat a été conclu intuitu personae.
Or, on peut admettre, sous réserves des remarques précédentes, que le contrat
de fiducie-sûreté est conclu intuitu
personae. Cela est en revanche plus difficile à admettre s’agissant de
contrat conclu avec une personne morale. Le cas de liquidation judiciaire
reste, à notre avis, sans fondement valable au regard du but de la
fiducie-sûreté.
Le law of trusts préconise de remplacer le trustee dans de telles circonstances.
La solution est bonne car elle tend à mettre en avant le but du trust qui ne saurait souffrir d’un
événement ne regardant que le trustee.
La règle s’exprime ainsi: A trust will
not fail for want of a trustee, un trust
ne tombe pas à la volonté d’un trustee.
Si la solution devrait être retenue lorsque la fiducie est utilisée à fin de
gestion ou de libéralité, elle est difficilement envisageable en matière de
fiducie-sûreté car le fiduciaire est également le créancier, or, remplacer le
fiduciaire, c’est devoir contracter un nouveau contrat de crédit et, bien
souvent, modifier le contenu du contrat de fiducie. N’est-il pas plus simple de
mettre fin à ce contrat et d’en conclure un nouveau ? La solution du
remplacement n’est cependant pas à exclure, aussi peut-on l’envisager.
On peut à cet égard
mentionner la disposition contenue à l’article 2070-1 alinéa 2 lequel prévoit
que « si le fiduciaire manque gravement à ses devoirs ou met en péril les
intérêts qui lui sont confiés, le constituant ou les bénéficiaires peuvent
demander (...) qu’il soit mis fin à la fiducie »; rien de particulier
jusque là puisqu’il s’agit d’un autre cas d’extinction de la fiducie lié au
comportement du fiduciaire. Force est de constater cependant que l’extinction
est dans ce cas une simple possibilité à la portée des parties, lesquels
peuvent lui préférer « la nomination d’un administrateur provisoire ou le
remplacement du fiduciaire ». Cette faculté permet de se rapprocher de la
solution anglaise qui est la bonne, à notre avis. Partant de cette
considération, et on pourrait espérer
que le juge, prenant conscience de l’intérêt, pour l’opération, que cette
dernière se poursuive en dépit des événements n’affectant que la situation
personnelle du fiduciaire, fasse une interprétation large de cet article
permettant d’étendre son champ d’application au cas provoquant une extinction
« artificielle » de la fiducie-sûreté.
Quittons cette
phase un peu noire dans laquelle la fiducie-sûreté se soumet à son sort, pour
retrouver le dynamisme actif de la fiducie-sûreté à travers l’étude de ses
effets.
Les parties à la
fiducie-sûreté ont conclu ce contrat afin que se produisent les effets attachés
à son régime, et notamment pour que le transfert de propriété des biens au
fiduciaire soit assorti d’obligations mises à sa charge. Le précédent chapitre
a été pour nous l’occasion de présenter ces obligations. Nous n’y reviendrons
pas. Nous devrons néanmoins nous y référer brièvement lorsqu’il s’agira, dans
le cadre d’une première section, d’apprécier les infidélités commises par le
fiduciaire au regard de celles-ci, au cours de l’exécution de la
fiducie-sûreté. La commission de telles infidélités pourront dans certains cas
se mesurer lors du dénouement de la fiducie-sûreté, une seconde section
permettra de s’en rendre compte.
Le fiduciaire et le
contrat, ce sont des obligations que le dernier met à la charge du premier, ce
sont les infidélités (§1) que le premier commet en violation du dernier.
Le constituant et
le contrat, ce sont les droits que ce dernier fait naître au profit du premier,
ce sont les actions (§2) que mettra en œuvre le premier afin de voir
sanctionnée la violation du dernier.
§ 1 Les infidélités
commises par le fiduciaire en violation du contrat
Etant donné les
diverses obligations qui pèsent sur le fiduciaire lors de l’exécution de la
fiducie-sûreté, les infidélités de ce dernier seront de diverse nature mais on
peut identifier deux sortes d’infidélités: les infidélités commises en
violation de ses obligations « personnelles » (A) et celles commises
en violation de son obligation propter
rem (B).
A La violation des
obligations « personnelles »
L’obligation est un
lien de droit entre personnes, elle a donc, par nature, un caractère personnel.
Nous nous permettons néanmoins de parler d’obligations
« personnelles » afin de les distinguer d’obligations d’une nature
particulière auxquelles le fiduciaire est tenu et que l’on appellera
obligations propter rem.
Les obligations
personnelles auxquelles le fiduciaire est tenu sont celles qui découlent
principalement de son obligation de loyauté: il s’agit, en gros, du devoir
d’agir dans l’intérêt du constituant et de remplir avec diligence les buts de
la fiducie.
A titre d’exemples
de violation de ces obligations personnelles, nous nous permettons d’emprunter
à la jurisprudence du common law laquelle
nous a inspirée quant aux obligations concrètes découlant du devoir de loyauté.
Il y a violation ou
manquement à l’obligation d’accomplir avec diligence les buts du trust; et de la fiducie, lorsqu’un trustee, et partant un fiduciaire, a
réalisé un investissement non permis lequel a résulté en une perte. Il y a
violation de son devoir d’agir dans l’intérêt du constituant lorsque le trustee ou le fiduciaire utilise à titre
personnel une information que sa position de trustee lui a permis d’acquérir.
On peut noter qu’il
n’y a rien de particulier qui différencie la violation de ces obligations
fiduciaires de celles qui résulteraient d’un autre contrat. En revanche, il en
va différemment pour ce qui concerne la violation de l’obligation propter rem.
B La violation des
obligations propter rem
Justification du choix de la
qualification
Nous qualifions propter rem les obligations qui
n’existent qu’ « à cause de la chose », ces obligations du fiduciaire
relatives au bien mis en fiducie et qui ont pour effet de détruire les
conséquences normalement attachées au droit de propriété sur ce bien, ie les obligations qui ont pour effet de
restreindre le droit du fiduciaire de disposer librement de son bien,
droit qui est une composante du droit de propriété dont il est titulaire sur ce
même bien. Certes, ce type
d’obligations « hybrides » est inconnu de nos classifications
juridiques mais nous pensons qu’admettre cette catégorie, c’est apporter une
solution aux incohérences qui se poseront irrémédiablement si on veut assurer
une efficacité de la fiducie en ne recourant qu’aux seuls outils dont dispose
le droit français.
D’ailleurs
avons-nous pu remarquer, à travers la rédaction de certains articles,
l’embarras des rédacteurs du projet devant ces incohérences.
Ils sont partagés entre le choix d’attribuer au fiduciaire la qualité de
propriétaire et celui
de ne lui conférer que des pouvoirs
lui permettant d’exercer les attributs de la propriété. Faute de trouver un
juste milieu, que permet justement la notion d’obligation propter rem, ils ont combiné leurs choix dans un ensemble, le
projet, qui ne pouvait être qu’incohérent.
On peut néanmoins noter avec intérêt la rédaction d’un article qui témoigne de
la prise de conscience, par les rédacteurs, du fait que la solution ne peut pas
efficacement se trouver dans l’une ou l’autre qualification, mais qu’elle se
trouve peut-être à mi-chemin entre les deux.
L’article 2068
futur du code civil dispose : «Dans ses rapports avec les tiers, le
fiduciaire est réputé disposer des
pouvoirs les plus étendus sur les biens et droits objet du contrat, à moins
qu’il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de
ses pouvoirs. » Il découle de cet article que le fiduciaire sera réputé propriétaire absolu à
l’égard des tiers. Or, la « réputation » se forge à partir d’éléments
apparents et non nécessairement réels. Interprété a contrario, il en résulte que le fiduciaire ne dispose pas des
pouvoirs absolus sur le bien, c’est admettre que son droit de propriétaire est
limité, non seulement dans ses effets, mais également dans son contenu. Cette
limite est précisément apportée par son obligation, que l’on peut, par voie de
conséquence qualifier d’obligation propter
rem. Nous verrons qu’adopter cette qualification, c’est reconnaître au
constituant un droit de nature particulière car corollaire de cette obligation.
Adopter une telle
catégorie présente l’intérêt de se rapprocher du degré d’efficacité du trust, lequel doit surtout cette
efficacité au droit de suite accordé au bénéficiaire, droit dont ne dispose pas
le constituant de la fiducie-sûreté telle qu’elle découle du projet. Cette
lacune dans le régime de la fiducie-sûreté est responsable du vice qui lui est
reproché, le manque de protection du constituant.
Enfin, l’adoption
de cette nouvelle catégorie de droit «hybride», se situant entre les droits réels et les droits personnels
permettrait d’éviter le recours trop fréquent que fait la jurisprudence à des
artifices juridiques. Elle en abuse même, afin de primer les titulaires de
créances relatives à l’acquisition d’une chose sur les titulaires de droit de
propriété sur cette même chose, lequel droit a été transféré après
l’attribution de ces créances et en connaissance de l’existence de celles-ci.
L’idée d’affectation fonde ces
obligations
Ces obligations ont
été mises à la charge du fiduciaire afin d’assurer que les biens sur lesquels
il exerce des prérogatives soient affectés au but poursuivi par les parties en
concluant le contrat.
En matière de
fiducie-sûreté, il s’agit de s’assurer que le fiduciaire conserve bien la
propriété du bien et ne le mêle pas avec ses biens personnels.
Deux obligations
principales reflètent ces préoccupations, ce sont l’obligation de conserver le
bien et l’obligation de ne pas confondre les biens de la fiducie avec ses biens
personnels. Nous nous sommes déjà intéressés à la première. Arrêtons-nous sur
la seconde.
Cette obligation
découle directement du fait que le fiduciaire va tenir les biens de la fiducie
séparés de son patrimoine personnel. Elle va permettre d’assurer l’efficacité
de cette précaution. Il ne servirait à rien en effet de créer cette masse
séparée du patrimoine personnel du fiduciaire si ce dernier pouvait placer les
biens mis en fiducie dans son patrimoine personnel.
Cette obligation
est la condition sine qua non de
l’efficacité de l’affectation des biens au but de garantie. A tel point que les
rédacteurs du projet y ont consacré un article 2069 « Le fiduciaire doit
prendre toutes les mesures propres à éviter la confusion des biens et droits
transférés ainsi que des dettes s’y rapportant, soit avec ses biens personnels,
soit avec d’autres biens fiduciaires ».
A la différence de
l’obligation de loyauté que nous avons pu classer dans les obligations de
moyens, nous pensons que ces obligations
sont de résultat en ce que le
fiduciaire est tenu à un résultat précis et la simple constatation que ce résultat
n’a pas été atteint conduit à la conclusion du manquement à ses obligations.
Le non-respect de l’affectation
des biens ou le manquement aux obligations propter rem
Le fiduciaire aura
manqué à son obligation de conserver le bien lorsqu’il aura aliéné ce bien à un
tiers. Si on admet que le fiduciaire est titulaire de pouvoirs et non de droits
pour l ’accomplissement de sa mission, on pourra alors parler de
« détournement de pouvoir »
en ce qu’il aura utilisé le pouvoir de disposition qui lui était conféré sur le
bien dans un but détourné de celui pour lequel ce pouvoir lui a été confié.
Ouvrons une parenthèse à ce propos. L’idée de recourir à la notion de pouvoirs
plutôt que de droit pour justifier que le fiduciaire soit tenu d’exercer les
prérogatives de la propriété dans un intérêt autre que le sien est certes
séduisante mais nous devons la rejeter. D’une part car, comme nous l’avons dit,
les rédacteurs du projet ont réellement tenu à attribuer au fiduciaire la
qualité de propriétaire, comme en témoigne la définition qu’ils ont retenue de
la fiducie.
D’autre part car
cette solution priverait de la fiducie-sûreté de l’efficacité recherchée par le
transfert de propriété: que les biens mis en fiducie échappent à l’assiette du droit
de gage général des créanciers du constituant-débiteur. Enfin et surtout, ce
serait faire un pas en arrière par rapport à la reconnaissance de droits
subjectifs grevés d’une affectation tel que le droit de propriété du
fiduciaire.
Certes le projet ne
consacre pas un tel droit, mais son embarras devant la nature juridique des
prérogatives du fiduciaire (droit ou pouvoir) est révélateur de la prise de
conscience, par les rédacteurs, de la réalité d’une telle catégorie de droits.
C’est encore la nécessité de respecter l’affectation de la propriété des biens
affidés qui justifie le devoir du fiduciaire d’isoler ces biens de ses autres
biens personnels dans son patrimoine.
Il manque à cette
obligation lorsqu’il en vient à confondre ces deux masses de biens: il en sera
ainsi lorsqu’il aura mêlé les fonds du patrimoine fiduciaire avec ceux de son
patrimoine personnel dans un compte bancaire commun.
La violation de
cette obligation ne se révélera qu’au dénouement de la fiducie, lorsqu’il
s’agira de rétrocéder les biens au constituant. En effet bien souvent, le
fiduciaire aura, le cas échéant, utilisé indifféremment ses fonds personnels et
les fonds fiduciaires. La question qui se pose est de savoir si le constituant
pourra réclamer des biens du patrimoine personnel du fiduciaire en cas de
dilapidation du patrimoine fiduciaire.
Cette question ne
trouvera réponse que lorsque nous aurons déterminé les droits et actions du
constituant de la fiducie-sûreté. Nous nous y prêtons à présent.
§ 2 Les droits et
actions du constituant à l’égard du fiduciaire
Les droits du
constituant reflètent ceux du fiduciaire. Les actions dont dispose le
constituant sont la contrepartie des obligations du fiduciaire. Aussi,
corrélativement aux obligations de nature strictement personnelle du
fiduciaire, le constituant sera titulaire de créances et d’actions personnelles
pour les sanctionner (A).
Surtout, le
caractère particulier que nous décidons d’attribuer au droit de propriété du
fiduciaire se retrouvera logiquement dans le droit du constituant en vertu
duquel il sera en droit d’exiger le respect de l’obligation propter rem, laquelle, rappelons, permet
d’assurer le respect de l’affectation de la propriété du fiduciaire. Le
caractère hybride de cette obligation déteindra logiquement sur l’action du
constituant par le biais de laquelle ce dernier sera en mesure d’en exiger
l’exécution. Plus concrètement, le constituant sera titulaire d’action de
nature hybride pour sanctionner son « droit à la chose » (B).
A Les actions personnelles
du constituant, sanctions de son droit de créance
Le régime des
actions personnelles du constituant obéit au droit commun des contrats. En
vertu de quoi, il pourra engager la responsabilité contractuelle du fiduciaire
pour manquement à ses obligations et obtenir réparation des dommages qui en
sont résulté, sur le fondement des articles 1146 et 1147 du code civil.
Le constituant
désireux d’agir en responsabilité contractuelle contre le fiduciaire pour
manquement à son obligation de loyauté et/ ou aux obligations qui en découlent,
devra rapporter la preuve d’une négligence fautive, source de dommages. En
effet, cette obligation n’est que de moyens.
Ainsi, un
fiduciaire aura fait preuve de négligence fautive lorsqu’il aura utilisé une
information pour son profit personnel que seule sa qualité de fiduciaire lui
permettait d’obtenir, plutôt que de l’utiliser au profit du patrimoine
fiduciaire.
En revanche,
s’agissant d’une violation à l’obligation de se conformer aux termes du
contrat, la simple constatation d’une non-conformité suffira à justifier la
condamnation du fiduciaire à réparation des dommages qui en sont résulté.
En effet, il n’y a
aucun aléa dans l’exécution de cette obligation, il s’agit d’une obligation de
résultat.
Le fiduciaire sera
également condamné à réparation des dommages conséquents à la violation de son
obligation propter rem en ce qu’il
aurait aliéné le bien à tiers acquéreur ou affecté le bien à une autre
utilisation que celle prévue au contrat.
Le cas échéant, on
pourrait imaginer une application de la sanction d’abus de confiance telle que
définie à l’article 408 du code pénal lequel ajoute le contrat de fiducie aux
contrats de remise de biens qui y sont énumérés. Ainsi le détournement de biens donnés en fiducie sera pénalement sanctionné.
Ces sanctions nous
semblent insuffisantes et impuissantes à protéger efficacement l’affectation du
bien. Il faut trouver la solution dans le droit particulier du constituant et
dans l’action qui le sanctionne.
B L’action
« hybride » du constituant, sanction de son ius ad rem
Justification du choix de la
qualification
Nous considérons
que le droit du constituant, à exiger l’affectation du bien au but de la
fiducie, but qui, une fois accompli, implique la rétrocession du bien à son
avantage, est plus qu’un simple droit de créance.
Nous avons déjà
longuement démontré en quoi ce droit personnel a un véritable effet de nature
« réelle » en ce qu’il confère à son titulaire une maîtrise faible
mais réelle sur le bien: d’une part l’idée d’affectation, d’autre part, la nécessaire rétrocession
rendent ce bien indisponible.
Le droit du
constituant est un droit à l’affectation de la chose et qui devient un droit à
l’acquisition de la chose au terme de la fiducie. Ce droit est le pendant, du
côté du constituant, de l’obligation propter
rem du fiduciaire. Nous avons choisi de qualifier ce droit « ius
ad rem » ie droit à la chose, droit à l’affectation de la
chose et droit à la rétrocession de la chose. Nous avons emprunté cette
qualification à celle parfois donné au droit de suite du beneficiary du trust. On
pourrait certes rétorquer qu’il n’y a pas ni de greffe ni de comparaison
possible entre les droits de ces deux personnes étant donné la division du
droit de propriété auquel aboutit le trust
et que permet la dualité common
law/equity. Expliquons les raisons
de notre choix.
Nous refusons de
tirer les conséquences scientifiques classiques d’obstacles devenus, par
l’effet du temps, juridiques. Ces obstacles ne doivent leur raison d’être qu’à
des considérations d’ordre politique et philosophique ou liées à l’intérêt
pratique des divisions et classifications.
Ainsi nous
dénonçons le concept de droit de propriété absolu et la summa diviso entre les droits réels et les droits personnels. Nous
avons déjà expliqué les raisons de notre rejet du concept civiliste de la
propriété. Quant à la summa diviso
entre les droits réels et les droits personnels, qui n’existe pas en common law, il est temps d’admettre que cette
distinction ne présente qu’un intérêt lié à la clarté juridique des opérations
et qu’en réalité, elle n’intéresse que la question de la relativité des droits.
Nous ne devrions pas tirer de cette distinction des conséquences autres que
celles qui lui étaient attribuées par ses « concepteurs ». Ici, nous
pensons à Gaius qui, s’il concevait la distinction, n’en classait pas néanmoins
les obligations, y compris la dette, dans la catégorie des biens.
Voici exposées les
raisons qui président à notre choix de rejeter le caractère normatif de cette summa diviso et nous conduit à admettre
l’existence de droits tenant, pour partie des droits réels et pour l’autre des
droits personnels, droit tel que celui du constituant de la fiducie-sûreté ou
du bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente. En outre, nous nous
appuyons sur la prise de conscience manifeste des rédacteurs du projet du fait
que le droit du fiduciaire se trouve en réalité quelque part entre un droit de
propriété et la simple disposition de pouvoirs sur la chose.
La solution réside
dans un droit de nature « hybride ». Le caractère hybride de ce droit
va naturellement se répercuter sur la nature de l’action qui permettra de le
faire valoir. Elle tiendra de l’action personnelle en ce qu’elle viendra
sanctionner la créance corollaire à l’obligation propter rem imposée au fiduciaire. Elle tiendra de l’action réelle
en ce qu’elle aura pour objet la reconnaissance d’un droit, certes non pas sur la chose (ius in rem) mais d’un
droit à la chose (ius ad rem). Intéressons-nous au
résultat de son exercice.
Exercice de l’action
Ni le projet, ni la
doctrine relative à la fiducie ne conçoivent de la sorte le droit du
constituant et l’action qui s’y rattache. Aussi, nous restons conscients de ce
que l’évolution que nous préconisons dans le sens de la reconnaissance du
caractère particulier du droit du constituant de la fiducie-sûreté ou du droit
du bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, n’est pas prêt de voir le
jour. Les blocages tiennent de la politique et de la science juridiques. De
plus, la question d’une évolution en ce sens n’est pas d’actualité, sans doute
parce que la greffe d’un organe étranger (un droit de nature hybride) dans
l’organisme (notre droit civil) fait souvent, en biologie comme en droit,
l’objet d’un rejet. Ces considérations nous amènent à appréhender en premier
lieu le droit du constituant et son exercice tel qu’il est envisagé dans le
projet. Ce n’est qu’en second lieu que nous envisagerons la situation du
constituant à partir des qualifications que nous avons retenues.
L’ « impotence » du
constituant simplement titulaire d’une créance
L’impuissance du
constituant à obliger
le fiduciaire au respect de ses obligations, notamment l’obligation de
conserver le bien et l’affecter au but de garantir le remboursement de la dette
va se mesurer lorsque le fiduciaire manque à ses obligations. En effet, outre
la réparation du dommage causé par ce manquement, le constituant ne va pas
pouvoir exiger le retour des biens dans le patrimoine fiduciaire lorsque le
fiduciaire l’aura dilapidé. La raison en est simple: faute d’être titulaire
d’un droit réel sur ces biens, il n’aura aucun pouvoir de suivre les biens
sortis du patrimoine fiduciaire en quelque main qu’ils se trouvent. La solution
sera d’autant plus vraie que ces biens seront passés entre les mains de tiers
acquéreur de bonne foi, nous y reviendrons lors de l’étude de l’effet du
contrat à l’égard des tiers. Limitons-nous pour l’instant aux rapports entre le
constituant et le fiduciaire. Simple titulaire d’une créance, le constituant
devra se résoudre à l’octroi d’une réparation accordée sur le fondement de la
responsabilité contractuelle du fiduciaire. S’agissant d’une obligation de ne
pas faire, obligation de ne pas aliéner le bien en sorte d’en préserver
l’affectation, le juge tendra à opter pour un mode de réparation par équivalent
sur le fondement de l’article 1142 du code civil,
fondement qui peut d’ailleurs être critiqué en ce que l’article 1142 ne vient
prohiber que la contrainte physique, que n’implique certainement pas l’idée de
réparation en nature de cette obligation. La réparation par équivalent devra
néanmoins être retenue s’agissant d’une obligation de ne pas faire dont la
violation ne peut être effacée. Il pourrait en aller différemment s’agissant de
l’obligation de rétrocéder le bien, ce que nous verrons lors du dénouement de
la fiducie. Mais nous en sommes encore à son exécution. Notre constituant
n’obtiendra donc à titre de réparation, qu’une créance mobilière sous forme de
dommages-intérêts et, lors de son exigibilité, il se retrouvera en concurrence
avec les autres créanciers chirographaires. Il se rangera pari passu avec ces derniers et se retrouvera même dépassé par les
créanciers privilégiés.
Une solution
« accessoire » à cette impotence
Une solution serait
de lui reconnaître un droit de suite né
d’une hypothèque ou autre sûreté réelle que le contrat de fiducie aurait
pour effet automatique d’accorder au constituant sur les biens fiduciaires.
Pour le cas où le bien affidé est un immeuble,
cas qui retient notre attention,
il pourrait s’agir d’une hypothèque légale imposée par la loi sur les biens
fiduciaires, à l’image de celle dont bénéficie l’époux sur les biens de l’autre
ou le légataire sur les biens de la succession.
En effet, le législateur a su reconnaître qu’un époux pouvait avoir un intérêt
particulier, souvent affectif, à acquérir le bien, dont souhaite se débarrasser
son époux, et a fait en sorte de protéger cet intérêt par préférence aux
potentiels acquéreurs. De même, il a reconnu qu’un légataire devait être
privilégié sur le bien légué lors de la liquidation de la succession. De la
même manière, le législateur pourrait reconnaître que le constituant a un
intérêt particulier à l’acquisition de ce bien par préférence à d’autres
potentiels acquéreurs, pour la simple raison que ce bien lui appartenait et
qu’il avait la ferme intention d’en récupérer la propriété au terme de la
fiducie. Fort de cette constatation, il pourrait tirer des conséquences
identiques à celles qu’il a tirées pour le cas de l’époux, celui du légataire
et d’autres encore, à savoir attribuer au constituant une hypothèque sur les
biens fiduciaires. Le constituant serait ainsi titulaire d’un droit de suite et
d’un droit de préférence en vertu desquels, il pourra saisir le bien en quelque
main qu’il se trouve ou, dans le cas où le bien aurait été vendu ou dilapidé,
d’obtenir, par le jeu d’une subrogation réelle, paiement de la valeur du bien
par préférence aux créanciers chirographaires.
Certes se
retrouverait-il encore concurrencé par les autres créanciers hypothécaires.
Mais il faut admettre que le constituant titulaire d’une telle hypothèque se
retrouverait dans une situation proche de celle du beneficiary du trust.
Faut-il encore que le législateur veuille bien attribuer cette hypothèque au
constituant. En attendant, on ne saurait que conseiller au constituant d’une
fiducie de constituer conventionnellement une hypothèque pour garantir
l’affectation du bien. Mais, admettons-le, tout cela devient compliqué, car il
s’agirait de greffer un accessoire à un contrat qui est lui-même accessoire
d’un autre contrat !
Force est de
constater en outre que le droit de suite du beneficiary
tendra à restituer les biens, non pas dans le patrimoine personnel de ce
dernier mais dans le trust fund.
Ainsi on le voit, attribuer une hypothèque au constituant ne reflète pas
totalement la situation du bénéficiaire, du moins durant l’exécution du trust et de la fiducie. L’idée de
l’hypothèque ne saurait prétendre
rapprocher le constituant de la situation du beneficiary que si on reconnaissait que le patrimoine fiduciaire
est doté de la personnalité juridique; l’hypothèque serait alors attribuée à ce
patrimoine, personne morale et l’exercice de son droit de suite aurait pour
effet de voir les biens, aliénés en dépit de leur affectation, retourner dans
le patrimoine fiduciaire. Telle est la solution à laquelle abouti l’exercice,
par le beneficiary, de son droit de suite (tracing
trust property). Mais le projet n’accorde pas la personnalité juridique à
la masse constituée par les biens mis en fiducie, il en fait juste une masse
séparée dans le patrimoine personnel du fiduciaire.
La solution
consiste à se rapprocher encore plus du trust
et à admettre que le constituant est titulaire d’un droit à la chose, similaire
à celui du beneficiary, droit qu’il
tiendrait en vertu du contrat de fiducie-sûreté et non en vertu d’une
hypothèque. C’est ce que nous nous proposons de faire à présent.
Le « potentiel » du
constituant titulaire d’un ius ad rem
...
Reconnaître à un
constituant la titularité d’un droit à la chose, c’est lui accorder un droit de
suite sur cette chose afin de voir replacer le bien dans le patrimoine
fiduciaire, afin de lui restituer son affectation. Ainsi on le voit, il s’agit
d’un droit très proche de celui du beneficiary,
droit de suite qu’il tient de son « droit équitable de propriété » (equitable interest). Par l’exercice de
son droit de suite, droit que lui confère son ius ad rem (qui est un droit à l’affectation de la chose durant
l’exécution de la fiducie), le constituant, à l’image du beneficiary, va pouvoir revendiquer le bien et obtenir son retour
dans le patrimoine fiduciaire,
sous réserve, bien entendu, de l’acquisition de bonne foi par un tiers. De
même, le droit de suite du beneficiary
ne peut pas s’exercer contre un tiers acquéreur de bonne foi.
... face à un fiduciaire qui a
aliéné le bien affidé à un tiers acquéreur de bonne foi
Le cas échéant, il
est admis dans le law of trusts que
le droit du beneficiary se reporte
sur la somme obtenue de l’aliénation du bien; cette sanction du fiduciaire est
celle du constructive trust. Le trust se reporte sur cette somme et le trustee est considéré comme constructive trustee de cette somme
qu’il doit donc conserver et affecter au but du trust. S’il le trust property
a permis l’acquisition d’autres biens, le trust se reporte sur ces biens. Pour être concrets, reprenons
l’exemple d’un auteur anglais: «
si le trustee malhonnête s’est
approprié les fonds du trust pour
acheter un Picasso pour lui-même, les bénéficiaires peuvent alors réclamer le
Picasso comme étant leur bien. S’il l’a vendu et a acheté un appartement avec
le produit de la vente et utilise régulièrement les loyers pour financer
l’achat à tempérament d’une Porsche, les bénéficiaires peuvent alors réclamer
l’appartement et la Porsche... ».
Il s’agit donc d’un
trust crée implicitement à titre de
sanction de la violation, par le trustee,
de son devoir de ne retirer aucun profit personnel de sa mission. On sait que
la fiducie ne se présume pas. Une telle sanction n’est donc pas envisageable en
matière de fiducie. Comment aboutir à une solution équivalente ?
On devrait pouvoir
atteindre une telle solution par le jeu de la subrogation réelle. Il suffit
d’admettre que la somme que le fiduciaire a retirée de la vente du bien affidé
a été subrogée à ce même bien dans le patrimoine fiduciaire.
... et face à un fiduciaire qui a
dilapidé les biens du patrimoine fiduciaire
Dans le cas d’une
fiducie-sûreté, la dilapidation des biens pourrait consister dans la destruction
de l’objet corporel cédé à titre de garantie, la dissipation de l’argent,
profit de la vente de ce bien corporel. Il s’agira rarement d’une simple
dissipation d’argent lorsque la fiducie-sûreté est accessoire à un prêt pour la
simple raison que le constituant ne saurait céder un capital monétaire à titre
de garantie, la disposition d’un tel capital ne justifiant plus le recours au
prêt. Néanmoins, dans le but de simplifier la démonstration, nous considérerons
que le patrimoine fiduciaire consiste dans un capital monétaire.
Deux cas de
situations peuvent se présenter dépendant du fait de savoir si le fiduciaire
avait ou non pris les mesures propres à éviter la confusion des biens
fiduciaires avec ses biens personnels, ce qui lui incombe à titre d’obligation.
Si le fiduciaire
avait pris ces mesures et qu’il a néanmoins dilapidé les fonds du patrimoine
fiduciaire, il n’y a plus de subrogation possible puisque le bien sur lequel
portait le droit de suite n’a pas été remplacé, il ne saurait y avoir de
subrogation avec les fonds de son patrimoine personnel. Le cas échéant, le
bénéficiaire s’aligne pari passu avec
les créanciers chirographaires du fiduciaire car il devient titulaire d’une
simple créance de dommages-intérêts du montant de la somme dilapidée. Cette
solution, inspirée de la jurisprudence anglaise
et des règles du law of trusts, est
parfaitement transposable pour la fiducie, comme on le voit, en utilisant le
mécanisme de la subrogation réelle. Il en va de même s’agissant du second cas.
Le fiduciaire n’a
pas pris ces mesures et a mêlé les fonds du patrimoine fiduciaire avec ceux de
son patrimoine personnel, puis a dilapidé une somme correspondant à la valeur
du patrimoine fiduciaire; le cas échéant, le droit anglais présume que le trustee a sans doute eu l’intention de
dilapider en premier lieu les fonds de son patrimoine personnel. Il en résulte
que si le patrimoine personnel contient une somme équivalent à celles du trust property, le trust va se reporter sur cette somme.
Les créanciers chirographaires devront se partager les fonds du patrimoine
personnel, diminués de ceux reportés dans le trust fund. Si cette solution parait injuste pour les créanciers
personnels du trustee, elle est de
bonne politique jurisprudentielle puisqu’elle suppose que le trustee est honnête: ie en disposant de fonds tirés de
l’ensemble des deux patrimoines confondus, il a certainement eu l’intention
d’utiliser en premier lieu ses fonds propres. Aussi pourrait-on transposer la
solution en matière de fiducie en admettant que la confusion des fonds rend
opératoire le mécanisme de la subrogation réelle. Par ce biais, les biens
fiduciaires dilapidés seraient subrogés par les biens personnels du fiduciaire
dans le patrimoine fiduciaire. Cette solution aurait d’une part le mérite de
protéger le patrimoine fiduciaire, et partant le droit du constituant, et
serait d’autre part, une sanction efficace à la violation par le fiduciaire de
son obligation de prendre les mesures propres à éviter la confusion des biens
fiduciaires avec ses biens personnels. On pourrait y voir un mode de réparation
en nature du manquement à cette obligation ; or la meilleure réparation en
nature consiste à mettre les parties dans la situation où elles se seraient
trouvées s’il y avait eu exécution conforme des obligations du contrat. Or, le
cas échéant, les fonds du patrimoine fiduciaire seraient restés intacts
puisque, conformément à son intention (présumant qu’il est honnête), il aurait
utilisé ses fonds personnels en premier lieu.
Le recours au
mécanisme de la subrogation réelle ne présente d’intérêt que si le constituant
est titulaire d’un droit de suite qui lui permette d’exiger le retour des biens
fiduciaires ou subrogés dans le patrimoine fiduciaire afin d’en assurer
l’affectation prévue mais également afin d’en retrouver la propriété lors du
dénouement de la fiducie.
« Lorsque la
fiducie prend fin, (...), les biens et droits subsistants font retour au
constituant ou à ses ayants causes. » (art. 2070-11 futur c.civ.).
« ...la valeur
du bien transféré au fiduciaire doit, en cas de défaillance du débiteur, être
déterminée à dire d’expert... » (art. 2065 futur c.civ.).
Voici énoncées, en
deux dispositions, les règles régissant la fiducie-sûreté lors de son
extinction.
La première régit
le dénouement de la fiducie-sûreté au cas de remboursement de sa dette par le
débiteur: c’est le dénouement « naturel » de la fiducie-sûreté (§1).
La seconde prévoit
les suites du dénouement de la fiducie-sûreté au cas de défaillance du
débiteur: c’est le dénouement « exceptionnel » de la fiducie-sûreté
(§2).
§ 1 Le dénouement
« naturel » de la fiducie-sûreté
La fiducie-sûreté
prend « naturellement » fin lorsque la dette qu’elle avait pour objet
de garantir s’éteint. A partir de là, le bien mis en garantie sera rétrocédé au
constituant-débiteur lequel a remboursé sa dette. La rétrocession du droit de
propriété au propriétaire initial soulève la question du mécanisme qui saura l’opérer
(A). L’intérêt de la question réside dans le choix que les parties devront
faire quant aux conditions de la rétrocession, conditions qui, en outre,
devront être stipulées au contrat.
Une fois le mécanisme retenu, sa mise en œuvre pourra se trouver confrontée à
des difficultés (B).
A Le mécanisme mis en
œuvre pour opérer la rétrocession du bien
Cette rétrocession est-elle le résultat de la
mise en œuvre d’une condition résolutoire à laquelle était assorti le transfert
initial de propriété ? Ou bien cette rétrocession ne résulte-t-elle que de
l’exécution de l’obligation propter rem du
fiduciaire ?
Le jeu de la condition résolutoire
du transfert initial de propriété
Dans cette
hypothèse, on admet que le transfert initial de la propriété est assorti d’une
condition résolutoire, le remboursement de la dette par le constituant tenant
lieu de condition.
Le remboursement de la dette par le constituant son
débiteur, tient lieu de condition
Cet événement
peut-il valablement constituer une condition ? Nous répondons par l’affirmative
car cet événement répond aux caractères requis par l’article 1168 du code
civil.
Cet événement est futur: une échéance est prévue. Il est incertain, en témoigne les précautions
prises par le créancier incertain d’être payé de constituer une sûreté. Cet
événement peut donc tenir lieu de condition.
Sa réalisation
dépend du constituant, son débiteur. N’y a-t-il pas là une condition
potestative ?
Non car sa
réalisation ne dépend pas de la volonté
arbitraire de son débiteur, le constituant, mais dépend de la réalisation
d’un acte déterminé dont il a des raisons sérieuses d’accomplir, à savoir
retrouver la propriété de son bien et dont la réalisation dépend d’une
circonstance indépendante de sa volonté, ce qui justifie, là encore, les
précautions dont s’entoure son créancier. Il s’agit d’une condition simplement
potestative et donc valable.
Plusieurs raisons
nous conduisent à repousser ce mécanisme.
Ce mécanisme occulte les effets naturels de la fiducie-sûreté
Considérer que la
rétrocession s’opère par le jeu de l’accomplissement de la condition
résolutoire affectant le transfert initial de propriété, c’est nier que le
fiduciaire soit tenu d’une obligation restreignant son droit de disposer,
obligation propter rem qui se
concrétise, au dénouement du contrat, par une obligation de donner. C’est en
réalité nier que le droit de propriété du fiduciaire soit restreint par une
quelconque obligation affectant son pouvoir de disposer de la chose, et
notamment de l’aliéner. C’est enfin nier que le constituant soit titulaire d’un
quelconque droit à la rétrocession de la chose à son avantage puisque le bien
lui sera rétrocédé, non en vertu de l’exécution par le fiduciaire de son
obligation de donner, corollaire du droit à la chose du constituant, mais par
le jeu de la réalisation de la condition résolutoire.
Bref, c’est encore
nier les effets réels du contrat de fiducie-sûreté et essayer de les aménager
par des mécanismes dont disposent le droit français.
Si on peut, par le
truchement du mécanisme de la condition résolutoire, retrouver les effets
naturellement attachés à la fiducie-sûreté, on ne peut, en revanche, éviter les
inconvénients d’un tel mécanisme.
Les inconvénients du mécanisme liés à la rétroactivité de
la condition
Lorsque la
condition se réalise, il se produit une rétroactivité des effets du droit
affecté par la condition, à savoir les effets du droit de propriété du
fiduciaire. Tout va se passer comme s’il ne l’avait jamais été. Il y a retour
au statu quo ante. Il doit restituer
le bien qu’il n’avait eu que sous condition résolutoire. Mais les inconvénients
se mesurent surtout à l’égard des tiers qui ont traité avec lui car on sait que
la résolution entraîne une cascade de résolutions. Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis. Ainsi, si le
fiduciaire, propriétaire sous condition résolutoire, avait grevé le bien
d’hypothèque, avait contracté une assurance dessus, tous ces actes sont à leur
tour annulés. Certes l’on sait aussi que cette règle de la rétroactivité des
conditions est purement supplétive et qu’il suffit, aux parties, pour y
déroger, d’insérer une clause dans le contrat qui écarte le caractère
rétroactif de la condition. Mais n’est-il pas plus simple de laisser la
fiducie-sûreté produire ses effets naturels, effets qui équivalent à ceux du
mécanisme sus-exposé mais en évitent les inconvénients. Aussi, n’est-il pas
artificiel de poser que les parties ont voulu le transfert définitif de la
propriété du bien au fiduciaire que seul un événement serait susceptible de
remettre en cause alors qu’il est de l’essence de la fiducie-sûreté que ce
transfert de la propriété soit voulu temporaire.
Nous préférons un
autre mécanisme lequel a l’avantage de prendre en considération les effets
naturels de la fiducie-sûreté.
Exécution de l’obligation propter rem du fiduciaire
Nous avons eu
l’occasion de montrer, outre la réalité de cette obligation, le contenu de
celle-ci. Lors du dénouement de la fiducie-sûreté, cette obligation consiste à
rétrocéder le bien mis en fiducie au terme du contrat. Cette obligation reflète
bien le but du contrat qui n’était d’accorder la propriété du bien au
fiduciaire que pendant le temps où cette propriété servirait de garantie.
Lorsqu’il n’y a plus lieu à garantie, le fiduciaire ne saurait conserver plus
longtemps cette propriété. Il doit naturellement rétrocéder cette propriété.
B Les difficultés
rencontrées lors de la mise en œuvre du mécanisme
Ces difficultés seront
principalement liées à l’impossibilité de rétrocéder le bien en ce que ce
dernier n’est plus dans le patrimoine fiduciaire. Soit le fiduciaire a aliéné
le bien à un tiers acquéreur, soit le fiduciaire a dilapidé ce bien.
Si on considère que
la rétrocession s’opère par la réalisation de la condition résolutoire auquel
était assorti le transfert initial de propriété, le constituant ayant remboursé
sa dette devient automatiquement propriétaire. Par l’effet de la rétroactivité
de la condition, son droit de propriété est considéré comme existant au jour du
transfert initial. Il en résulte que les tiers acquéreur n’ont pu valablement
acquérir la propriété du fiduciaire lequel est considéré comme n’ayant jamais
été propriétaire. Or, nemo dat quod non
habet. Ce mécanisme semble conférer une grande protection au constituant
mais on sait que la jurisprudence tend à neutraliser les effets de cette
rétroactivité pour des raisons qui tiennent, parfois, à l’existence d’une
obligation de garantie,
le plus souvent, à des impératifs de sécurité.
Par un mécanisme de subrogation réelle, le droit de propriété du constituant se
reportera sur le profit que le fiduciaire aura retiré de la vente. En cas de
dilapidation, il sera simplement titulaire d’une créance de dommages-intérêts.
Si on admet que la
rétrocession s’opère par exécution de l’obligation propter rem du fiduciaire, le fiduciaire va pouvoir exercer son
droit de suite assorti à son droit à la chose et revendiquer le retour du bien
initialement cédé ou subrogé, mais cette fois, non pas dans le patrimoine
fiduciaire mais dans son propre patrimoine. Excepté cette différence, les
solutions sont identiques à celles exposées supra
relatives à l’exercice du droit de suite lors de l’exécution du contrat. De la
même manière, le constituant ne pourra plus exercer son droit de suite lorsque
les biens ont été dilapidés et il sera titulaire d’une simple créance de
dommages-intérêts.
Nous éviterons les
redits en clôturant ici ce point.
Pourrait-on
imaginer que le législateur désireux d’agir dans le sens d’une meilleure
protection du constituant, lui accorderait le bénéficie d’un privilège spécial
de même qu’il a pu l’accorder au « vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le
payement du prix ».
On peut admettre que le vendeur est titulaire d’un véritable droit de propriété
sur la créance de somme d’argent consistant dans le prix de la vente, de même
que le constituant retrouve son droit de propriété sur le bien.
Mais ce ne sont
qu’hypothèses et incertitudes. Le projet apporte-t-il plus de certitudes ? La
question du dénouement exceptionnel de la fiducie-sûreté ne permet pas de s’en
convaincre.
§ 2 Le dénouement
« exceptionnel » de la fiducie-sûreté
Le remboursement de
la dette entraîne naturellement la rétrocession du bien mis en fiducie.
Exceptionnellement, le bien ne sera pas rétrocédé. Il en sera ainsi en cas de
défaillance du constituant lorsqu’il n’aura pas remboursé à terme la dette dont
il est débiteur. La solution est classique.
Elle est implicite dans le projet. Ce dernier fait indirectement référence au
devenir du bien lorsqu’il prévoit que « la valeur du bien transféré au
fiduciaire doit, en cas de défaillance du débiteur être déterminée à dire
d’expert... ». Il en résulte qu’au cas exceptionnel de non-remboursement
de la dette, la fiducie-sûreté se dénoue par la non-rétrocession du bien au
constituant (A) et le désintéressement du fiduciaire (B).
A La non-rétrocession
du bien au constituant
L’événement tenant lieu de
condition ne s’est pas produit
Telle est la justification
de la non-rétrocession du bien si on considère que le transfert initial de la
propriété était assorti d’une condition résolutoire. La condition ne s’étant
pas réalisé à terme, elle est considérée comme défaillie en application de
l’article 1176 du code civil.
Il en résulte
logiquement que le fiduciaire devient propriétaire définitif du bien cédé à
titre de garantie. Le second mécanisme donne le même résultat.
Le fiduciaire n’est pas tenu
d’exécuter son obligation de rétrocéder le bien
Le non-remboursement
de la dette par son débiteur, le constituant, suspend le fiduciaire de son
obligation de rétrocéder le bien qui lui a été transféré à titre de garantie.
Faut-il en conclure que l’obligation de
rétrocéder le bien a été conclue sous condition suspensive du remboursement de
la dette par le constituant ? De même que pour le mécanisme de la condition
résolutoire affectant le transfert initial de propriété, le remboursement de la
dette peut valablement tenir lieu de condition. Là encore nous déplorons un tel
mécanisme.
En effet, il est
traditionnellement admis que la condition suspensive est celle qui affecte la
naissance de l’obligation. Ce serait alors admettre que l’obligation du
fiduciaire ne naît, certes rétroactivement, que lorsque l’événement se produit.
Ce serait donc nier que le fiduciaire est tenu d’une obligation de rétrocéder
le bien au terme du contrat et corrélativement nier que le constituant serait
titulaire d’un droit à la chose. Or, cette obligation propter rem et ce ius ad rem sont,
à notre avis, de l’essence de la fiducie. Ce n’est pas parce qu’on utilise la
fiducie à fin de sûreté que les éléments essentiels de ce contrat doivent s’en
trouver modifiés. En effet, en matière de fiducie-gestion ou de
fiducie-libéralité, il n’est pas question de remettre en cause l’obligation du
fiduciaire de transférer la propriété au bénéficiaire au terme du contrat.
Pourquoi en serait-il ainsi en matière de fiducie-sûreté ? Sans doute parce
qu’on raisonne à partir des conséquences traditionnelles de la défaillance du
débiteur dans les cas où son créancier aura constitué une sûreté. En effet, on
sait que dans ce cas, il y aura en principe réalisation de la garantie et donc
paiement sur le bien donné en garantie.
Il serait plus
conforme à l’essence de la fiducie-sûreté d’insérer dans le contrat une
stipulation selon laquelle, en cas de défaillance du débiteur, le fiduciaire ne
sera pas tenu de son obligation de rétrocéder le bien et qu’il pourra le
réaliser. Certes le résultat est le même mais cette dernière proposition nous
semble plus respectueuse des effets de la fiducie-sûreté. En outre, cette
stipulation viendrait en quelque sorte « consacrer »
l’interdépendance des deux contrats: elle vient instaurer une sorte d’ «
exception d’inexécution » liant les deux contrats; on permet au
fiduciaire, en cas de non exécution par le débiteur de son obligation née du
contrat principal, d’invoquer l’exception d’inexécution afin de se décharger de
l’exécution de son obligation née du contrat accessoire.
Quel que soit le
mécanisme retenu par les parties, le fiduciaire ne va pas rétrocéder la
propriété du bien.
B Le désintéressement
du créancier- fiduciaire
La conservation du bien
Le fiduciaire, resté
propriétaire, pourra en rester là et se désintéresser par la conservation de la
propriété.
On voit déjà les
travers de ce mode de désintéressement, travers contre lesquels la prohibition
du pacte commissoire a été dressée. La plupart du temps en effet, le bien cédé
à titre de garantie excédera le montant de la dette à rembourser.
Or, la situation du
fiduciaire conservant le bien à titre de réalisation de la sûreté est très
proche de celle d’une mise en œuvre d’un pacte commissoire. Le pacte commissoire
est celui qui permet au créancier de s’approprier le bien servant de garantie
en cas de défaillance du débiteur, sans le faire auparavant attribuer par
décision de justice. La similitude est manifeste.
Si on admet que le
fiduciaire puisse garder la propriété du bien à titre de paiement, le risque
est celui d’une spoliation du constituant-débiteur. En outre, admettre un tel
mécanisme reviendrait à légitimer un pacte commissoire, par le biais d’un
contrat non visé par cette prohibition et donc non concerné.
Le danger d’une
telle fraude déguisée n’est pas écartée par la disposition du projet lequel
réserve l’hypothèse d’un choix par les parties du mécanisme permettant le
désintéressement du créancier-fiduciaire.
Ce dernier pourra
également réaliser le bien et se payer sur le prix de vente du bien.
La réalisation privée du bien
Les parties peuvent
décider conventionnellement que le créancier vendra le bien à l’amiable et se
paiera sur le prix obtenu. Si le produit de la réalisation excède le montant de
la dette à payer, le créancier devra restituer le surplus au débiteur. Là
encore le mécanisme retenu n’est pas à l’abri de toute critique. En effet, le
risque est que le créancier impose au débiteur une estimation de prix mais en
demande un prix plus élevé à la vente, afin de récupérer, outre le montant de
sa créance, la somme correspondant à la différence entre le prix annoncé au
débiteur et le prix réellement obtenu. Le débiteur se retrouverait encore
spolié par son créancier. Ce mode de réalisation du bien n’est autre que la
mise en œuvre d’une clause de voie parée, laquelle est également prohibée. Mais
de même que pour le cas précédent, la prohibition ne joue que pour le gage et
l’antichrèse. La fiducie-sûreté est à l’abri d’une sanction pour contravention
à l’interdiction de la clause de voie parée.
Bien que non
prohibés, une suspicion d’illiceité va peser sur ces modes de dénouement
« exceptionnel » de la fiducie-sûreté. On ne saurait, dès lors, se
satisfaire de la situation. Partant de cette considération, il faut accueillir
la disposition du projet
comme une solution potentielle à cette situation regrettable.
La réalisation du bien évalué à
dire d’expert
Les rédacteurs du
projet prennent conscience de ce qu’une vente amiable est généralement plus fructueuse
qu’une vente aux enchères. Aussi prennent-ils soin d’entourer la vente du bien
de précautions pour limiter le risque d’une spoliation du débiteur. Ils
prévoient une détermination de la valeur du bien à dire d’expert ou en fonction
de leur côte sur un marché organisé s’il s’agit de contrats ou valeurs
mobilières.
Ce système est bon
mais son efficacité ne saurait véritablement être assuré que si les parties
n’étaient pas autorisées à s’en écarter. Or, c’est précisément le cas puisqu’il
ne sera fait recours à ce mécanisme que par défaut, ie « si le contrat de fiducie conclu à des fins de garantie
n’en a pas disposé autrement ». Cela nous semble regrettable car la
spoliation du débiteur doit être un souci majeur s’agissant de la réalisation
des sûretés. La solution du projet a le mérite d’apporter un minimum de
sécurité au débiteur et elle nous semble peut contraignante pour le vendeur.
Pourquoi ne pas l’imposer ? Les rédacteurs du projet priment-ils la liberté
contractuelle ?
Y a-t-il vraiment
lieu de privilégier la volonté des parties sur des préoccupations liées à des
impératifs de sécurité lorsque l’on sait que la jurisprudence n’hésite pas à
faire triompher ces impératifs de sécurité lorsqu’il s’agit de protéger des
tiers aux dépens de la volonté exprimée des parties.
CHAPITRE
II - LES EFFETS DE LA FIDUCIE -SURETE A L’EGARD DES
TIERS
« Les tiers
ont le droit d’être laissés tranquilles ». Ainsi Carbonnier exprimait le
principe de la relativité des conventions auquel le contrat de fiducie-sûreté est
naturellement soumis.
Mais il est traditionnellement entendu que ce principe ne s’applique qu’aux
tiers absolus, les penitus extranei.
La formule de l’article 1165 du code civil selon laquelle le contrat ne nuit,
ni ne profite aux tiers, ne saurait s’appliquer aux ayants causes et créanciers
des parties (Section I), lesquels vont « souffrir » ou profiter de
l’existence du contrat de fiducie. Il en va différemment pour le tiers
acquéreur d’un bien affidé (Section II), entièrement étranger au contrat, et
aux cocontractants.
Les ayants causes
des parties, à titre universel ou à titre particulier, tiennent leur droit de
l’une ou l’autre des parties, leur auteur. Les créanciers sont titulaires d’un
droit de créances à l’encontre de l’une ou l’autre partie, leur débiteur.
Analysons successivement les situations de ces deux catégories lorsqu’elles se
retrouvent confrontées à la fiducie-sûreté contractée par leurs auteur et
débiteur.
§ 1 Situation des
ayants causes des parties à la fiducie-sûreté
Le bien servant à garantie sort du
patrimoine du constituant
La fiducie-sûreté
réalise le transfert de propriété d’un bien, du patrimoine du constituant, vers
le patrimoine fiduciaire, masse séparée dans le patrimoine personnel du
fiduciaire. Le bien sort du patrimoine personnel du constituant, on comprend
dès lors l’intérêt de ses ayants causes à une telle transaction. En effet, ces
ayants causes bénéficient d’une fraction du patrimoine, ou d’un droit sur le
patrimoine de leur auteur, le constituant. Le bien mis en fiducie sortant du
patrimoine du constituant, le droit d’un ayant cause à titre particulier ne
s’exercera pas sur ce bien, et ce bien ne sera pas compris dans la fraction du
patrimoine dont bénéficie un ayant cause à titre universel. Il en résulte
qu’« en cas de décès du fiduciaire, les biens et droits objet de la
fiducie ne font pas partie de sa succession ».
La protection des héritiers
réservataires du constituant
On sait qu’une personne
peut disposer à sa guise de son patrimoine dans la seule limite de la quotité
disponible en présence d’héritiers réservataires. Ces derniers ont en effet
droit à une portion du patrimoine de leur auteur, dont il ne saurait les
priver. Cette portion est la réserve héréditaire, le respect de laquelle
justifiant que ses bénéficiaires puisse agir en réduction des libéralités et
donations consenties par leur auteur au-delà de la quotité disponible.
Forts de cette
préoccupation, les rédacteurs de projet ont adopté des dispositions
afin que la constitution d’une fiducie, dont les biens qui en font l’objet sont
exclus de la succession du constituant, ne porte pas atteinte aux droits des
héritiers réservataires. Ils en font un principe: « La fiducie ne peut
porter atteint aux droits des héritiers réservataires », et en tirent les
conséquences: « Si, lors du décès du constituant, la valeur des biens et
droits transférés au fiduciaire excède la quotité disponible, la fiducie est
réductible ». Nous ne rentrerons pas dans les détails de ces dispositions
lesquels intéressent une autre matière et nous semblent superflus au regard des
buts de la présent étude.
Il nous semble
néanmoins intéressant de voir brièvement ce qu’il en est outre-Manche
Le trust est « mis de côté » afin de protéger le
conjoint et membres de la famille du constituant
Le conjoint marié
est protégé par le Matrimonial Causes Act
1973 contre les dissipations de
l’autre. Il pourra demander que le trust
soit mis de côté (set aside) à son
égard lorsqu’il porte par exemple sur la maison familiale. Cette sanction
équivaut à notre sanction d’inopposabilité. Un sanction plus efficace
consistera à conférer un equitable
interest au conjoint en vertu d’un resulting trust .
La loi présume que la contribution financière du conjoint à l’achat de la
maison familial, ou le simple entretien de la famille correspond en réalité à
un intention implicite d’acquérir un intérêt équitable (presumption of advancement), même si l’autre conjoint a acquis le
bien en nom propre. La loi impose un trust
en conférant au conjoint acquéreur le legal
estate et l’equitable interest à
l’autre conjoint. L’idée est d’imposer à une personne mariée le devoir moral de
subsister aux besoins de son conjoint.
La jurisprudence a étendu cette solution aux couples non mariés et ...
homosexuels !
En outre, la
famille et les personnes à charge sont protégés par l’Inheritance Act 1975 contre les personnes qui, souhaitant
déshériter leur famille,
transfèrent leur biens en trust au
bénéfice de personnes déterminées ou dans un but charitable. Ils pourront
obtenir du juge une restitution du bien, en nature, ou en valeur en cas
d’impossibilité de fait ou de droit de restituer la chose.
Le trust sera dans certains cas
inopposables aux créanciers du settlor.
N’allons pas plus loin, la question intéresse le second paragraphe.
§ 2 Situation des
créanciers des parties à la fiducie-sûreté
La fiducie-sûreté
nuit aux créanciers chirographaires du constituant en ce que le transfert de
propriété qu’elle implique vient réduire l’assiette de leur droit de gage
général. Mais il ne vient pas pour autant profiter aux créanciers personnels du
fiduciaire puisque le bien cédé à titre de garantie ne fait pas partie de son
patrimoine personnel mais d’une masse séparée affectée au but de la fiducie.
Est-ce à dire que le bien ne va profiter à aucun créancier ?
Les droits des créanciers fraudés
par le constituant
L’adage Fraus omnia corrumpit semble avoir fait
écho de part et d’autre de la Manche.
Le projet prévoit
que « ...hors le cas de fraude aux droits des créanciers du constituant,
les biens transférés au fiduciaire ne peuvent être saisis... ».
La lecture a contrario de l’article
rend applicable en matière de fiducie l’article 1167 du code civil qui consacre
l’action paulienne en vertu de laquelle les créanciers peuvent, « en leur
nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leur
droits ». Devant la preuve que la fiducie-sûreté aura été constituée en
fraude des droits des créanciers, le juge pourra déclarer la fiducie
inopposable au créancier demandeur à l’action et les biens mis en fiducie
réintégreront le patrimoine du constituant. Ils réintégreront du même coup
l’assiette du droit de gage général des créanciers qui pourront alors les
saisir.
De la même manière,
le Law of Property Act 1925 et l’Insolvency Act 1986 sanctionnent toute
transmission de biens faite en fraude des droits des créanciers,
et l’equity refuse de régir un trust frauduleux.
Intéressons-nous à
un cas particulier de fraude.
La fraude du constituant d’une
fiducie en période suspecte
Le projet ajoute un
8é alinéa à l’article 107 de la loi du 25 janvier 1985,
lequel prévoit que tout acte de fiducie sera annulé s’il est effectué après la
cessation de paiements. Il s’agirait d’une nullité obligatoire qui anéantit
rétroactivement l’acte. Si la fiducie a été constituée dans les six mois
précédant la date de cessation des paiements, elle pourra être annulée mais il
s’agit là d’une nullité facultative, la fraude du constituant devant être
prouvée. Ce cas de fraude à l’égard des créanciers a son équivalent anglais.
L’Insolvency Act autorise le juge dans un
délai de deux ans entre le transfert des biens et la faillite du constituant, à
prononcer l’inopposabilité de l’acte aux créanciers. La différence est qu’en
l’espèce, le juge peut prendre cette décision, même si le constituant était
solvable au moment du transfert, tandis que le juge français ne peut remonter
qu’à six mois avant la date de cessation de paiement.
Certes d’autres
différences, manifestes, existent, mais nous écourtons la question qui n’est
traitée qu’à titre d’exemple, elle a déjà pris trop de place dans le
développement.
Le droit de suite des créanciers
du constituant munis de sûreté
L’article 2069
alinéa 2 futur du code civil pose que « les biens transférés ne peuvent
être saisis (...) hors préjudice des droits des créanciers du constituant
titulaires d’un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au
contrat de fiducie ». Cela signifie par exemple que le titulaire d’une
hypothèque inscrite antérieurement au contrat de fiducie-sûreté conservera son
droit de suite au cas de transfert ultérieur de l’immeuble à titre de garantie.
Cette solution est
liée à l’opposabilité erga omnes des
droits réels. Elle est similaire en droit anglais s’agissant des charges (easements)
qui peuvent grever les biens mis en trust.
Ces charges sont opposables au trustee
et aux bénéficiaires du trust.
L’action oblique des créanciers du
constituant à l’extinction de la fiducie-sûreté
Il faut se souvenir
que la fiducie-sûreté s’éteint naturellement par le remboursement de la dette
par le constituant et il en résulte la rétrocession du bien au constituant. A ce
moment, le bien réintègre normalement le patrimoine du constituant et du même
coup l’assiette du droit de gage général des créanciers chirographaires. Mais
on a vu qu’il pouvait y avoir des difficultés à cette rétrocession liées au
refus du fiduciaire ou à l’impossibilité de restituer le bien. A ce stade, nous
avons considéré que le constituant était titulaire d’un droit de suite
découlant de son droit à la chose.
Il peut arriver cependant que notre constituant, pour diverses raisons, renonce
délibérément à exercer son droit de suite pour récupérer soit la propriété du
bien initialement cédé, soit un bien qui lui serait subrogé. L’article 1166 du
code civil permet aux créanciers du constituant négligent, par le jeu de
l’action oblique, d’ »exercer tous les droits et actions de leur
débiteur ». Ils pourront également exercer l’action personnelle du
constituant afin de faire sanctionner la manquement à ses obligations du
fiduciaire. Les dommages-intérêts qui seront alloués à ce titre intégreront
l’assiette de leur droit de gage général.
Le droit de gage général des
« créanciers de la fiducie »
L’article 2069
alinéa 2 futur du code civil dispose que, hors les exceptions ci-dessus
exposées, « les biens transférés au fiduciaire ne peuvent être saisis que
par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ces
biens par le fiduciaire ». Le droit de ces créanciers ne constitue pas une
exception à l’interdiction de la saisie par les créanciers personnels du
fiduciaire puisque leur créance est née dans le patrimoine fiduciaire. Ces
créanciers sont ceux qui vont profiter le plus directement du bien affidé
puisque leur droit de gage général va porter sur le patrimoine fiduciaire
constitué par le contrat de fiducie-sûreté.
De ces remarques,
il ressort que les parties, pour prolonger la formule de Carbonnier, « ont
le droit d’être dérangés » par des tiers au contrat de fiducie-sûreté. Ces
tiers ne sont pas les penitus extranei
visés par l’article 1165 mais plutôt des tiers qui ont une situation intermédiaire
entre celle des parties et celle des « véritables » tiers. Mais on va
pouvoir constater que même de véritables tiers pourront perturber la vie du
contrat.
Voici un tiers qui
acquiert un bien appartenant au patrimoine de la fiducie, compromettant du même
coup l’affectation de ce bien durant l’exécution de la fiducie-sûreté, et
empêchant sa restitution au constituant au terme de celle-ci. Le constituant se
trouve indéniablement dérangé par cette acquisition et nous avons vu qu’il va
pouvoir agir en responsabilité contre le fiduciaire et en restitution du bien.
Le tiers acquéreur va se trouver menacé par le second type d’action laquelle
tend à lui retirer la propriété du bien acquis. Déjà, nous avions signalé que
le succès de cette action dépendra du point de savoir si le tiers a pu
valablement acquérir le bien. Le traitement de cette question nous conduit à
dresser une distinction entre deux cas de situations que nous étudierons
successivement. Le tiers a acquis le bien de bonne foi (§1) ou le tiers a
acquis le bien de mauvaise foi (§2).
Avant d’entrer dans
le développement, ouvrons une brève parenthèse. Dans l’analyse qui suit, nous
traitons du problème en matière immobilière car le problème se posera plus
rarement en matière mobilière. En effet, le constituant conserve la possession
du bien, il sera
dès lors plus difficile pour un fiduciaire de prétendre transférer la propriété
d’un meuble sans pouvoir livrer le bien au terme de la négociation, ou sans
même pouvoir présenter ce bien. Au demeurant, si l’hypothèse se présente, le
tiers entré en possession du bien sera protégé par la formule de l’article 2279
du code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre ».
§ 1 Le tiers a
acquis le bien affidé de bonne foi
Si le fiduciaire,
propriétaire ès-qualité, transfère à un tiers la propriété d’un bien affidé,
l’aliénation est valable s’il a ignoré la limitation des pouvoirs du
fiduciaire. ces éléments suffiront à constituer la bonne foi de l’acquéreur
(A). Dès lors, en vertu de l’effet normatif de la bonne foi fondée sur
l’apparence(B), il sera admis que le tiers acquéreur est plein titulaire de la
propriété du bien.
A Les éléments constitutifs
de la bonne foi de l’acquéreur d’un bien affidé
Le tiers sera
constitué de bonne foi dès lors qu’il n’aura pas eu connaissance de la qualité
de fiduciaire de son auteur, qualité qui venait précisément interdire à ce
dernier d’aliéner le bien affidé à un tiers au contrat, et obliger ce tiers à
respecter cette situation de fait créée par le contrat. Si la bonne foi est
présumée de principe,
un tiers acquéreur doit en outre prouver que des circonstances ont pu
raisonnablement le conduire à croire en la qualité apparente que son auteur
revêtait d’un propriétaire absolu du bien. C’est la preuve de l’ «erreur
commune » pour que joue l’adage Error
communis facit jus. Le projet vient faciliter le travail de la preuve du
tiers en consacrant cette apparence mais il faudra prendre acte, dans certains
cas, de l’incidence des règles de la publicité foncière.
Le fiduciaire est présumé
propriétaire apparent
Le projet consacre
l’apparence de propriétaire que revêt le fiduciaire en posant que « dans
ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposé des pouvoirs les plus étendus sur les biens et
droits objet du contrat »; il s’agit là d’une présomption simple donc
susceptible de preuve contraire car le projet ajoute « à moins qu’il ne
soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de
pouvoirs ». Le projet fait un pas considérable dans l’évolution de la
théorie de l’apparence puisqu’il vient dispenser celui qui invoque l’apparence
de rapporter des éléments de circonstances tendant à prouver l’apparence.
Certes, nous savons que la sécurité juridique est un des soucis majeurs du
droit contemporain. Mais il y a là un risque que des tiers trop crédules,
négligents ou même de mauvaise foi profitent de cette présomption, ce qui
serait regrettable. On risquerait de perdre une composante fondamentale de
l’apparence créatrice de droit, l’exigence du caractère légitime de l’erreur,
ou de la croyance.
Or, comme l’exprimait Pierre Voirin, « la théorie de l’apparence n’est pas
une planche de salut à l’usage des négligents et des étourdis, mais une
protection réservée aux victime d’une croyance légitime ».
Fort heureusement
en matière immobilière, domaine où les conséquences d’une apparence pourraient
être graves pour le constituant, il faudra prendre acte des règles de la
publicité foncière.
Mais avant de
considérer l’incidence de ces règles, voyons comment le common law appréhende une telle situation en matière de trusts.
Equitable interests bind the whole
world except Equity’s Darling (le droit du beneficiary est opposable erga omnes
sauf à l’égard du protégé de l’equity)
Il résulte de cette
formule que le bénéficiaire du trust,
à qui le bien sera transféré ou rétrocédé, (s’il est également le settlor, à l’image de notre constituant
de la fiducie-sûreté), pourra opposer son equitable
interest à tout tiers acquéreur du bien. Il opposera son droit au tiers en
exerçant son droit de suite sur le bien mais, comme nous le verrons au
paragraphe suivant, ce tiers supportera de plus lourdes conséquences que notre
acquéreur d’un bien affidé de mauvaise foi. La formule considérée pose une
exception à l’opposabilité erga omnes du
droit du bénéficiaire du trust. Il
s’agit du cas de l’Equity’s darling.
Une question se pose: qui est l’Equity’s
darling, ce « protégé » des règles d’equity qui va échapper aux conséquences de l’opposabilité de l’equitable interest du bénéficiaire ? La
réponse est sans surprise: il s’agit de l’équivalent de notre acquéreur de
bonne foi, the bona fide purchaser for value
of the legal estate
without notice. La dénomination est longue, mais elle est celle qui figure
dans les décisions. Elle est surtout très explicite quant aux conditions que
doit remplir une personne pour échapper à l’opposabilité du droit du bénéficiaire
et du même coup, prétendre avoir acquis absolument le bien. Il doit être bona fide, ie de bonne foi. La bona fide
se caractérise de manière similaire à celle requise pour que joue la théorie de
l’apparence: l’equity requiert non
seulement l’ignorance de l’existence de ce droit sur le bien (without notice)
mais encore que cette ignorance soit légitime (genuine) et honnête (honest).
L’equity requiert en outre que
l’acquéreur (purchaser) ait acquis le
bien en fournissant une contrepartie (for
value) car l’equity ne protège pas les ~donataires, Equity will not protect a volunteer.
L’acquéreur qui
remplit ces conditions aura pu acquérir le bien « absolument », ie libéré du droit du bénéficiaire sur
ce bien. Cette solution à laquelle aboutit l’application de la doctrine of notice, qui remplit le rôle
de notre théorie de l’apparence, sera également neutralisée par le système
anglais de la publicité foncière.
Incidence des règles de la
publicité foncière
Le tiers acquéreur
ne pourra plus se prévaloir de l’apparence de véritable propriétaire que revêt
le fiduciaire, ie de sa qualité
réelle de fiduciaire dès lors que la fiducie-sûreté porte sur des droits et
biens dont la mutation est soumise à publicité. En effet dans ce cas, le projet
prévoit que le nom du fiduciaire ès-qualité doit être mentionné. Il s’agit
d’une mesure de publicité obligatoire
qui est donc sanctionnée par l’opposabilité de l’information publiée. La
présomption posée par le projet ne joue plus puisque dans ce cas, la publicité
est constitutive de la preuve contraire. Le tiers aura alors acquis le bien de
mauvaise foi, nous y reviendrons dans le paragraphe suivant.
De la même manière,
le système anglais de la publicité foncière rend inopérante la doctrine of notice s’agissant des titres
publiés puisqu’il est considéré que la publication d’un titre équivaut à la
connaissance véritable
Poursuivons avec
l’hypothèse d’un acquéreur de bonne foi et voyons les effets de sa bonne foi.
B L’effet normatif de
la bonne foi de l’acquéreur d’un bien affidé
La bonne foi de
l’acquéreur (il croyait le fiduciaire propriétaire) fondée sur l’apparence (il
ignorait la qualité de fiduciaire) va être source de droit car Error communis facit jus.
Dès lors,
l’acquéreur aura valablement acquis un droit de propriété créé par l’apparence.
Le constituant ne pourra plus prétendre récupérer du patrimoine fiduciaire la
propriété d’un bien qu’il n’avait plus et qui est désormais entre les mains
d’un tiers. En effet car nul ne peut aliéner la propriété d’autrui
et car prior tempore, potior jure, le
droit le premier dans le temps l’emporte en droit. Le tiers devra néanmoins
être vigilant et publier son titre, s’agissant d’un bien immobilier. Car si le
constituant, alors que la propriété du bien lui est restitué, cette fois en
fraude du droit du tiers, publie son droit en premier, il l’emporte en fait car
dans ce cas, ce n’est pas le premier droit qui l’emporte mais le premier
publié.
On parvient à une
solution identique avec la doctrine of
notice puisqu’on déclare inopposable à l’acquéreur de bonne foi le titre
équitable du bénéficiaire. Il en ressort que l’acquéreur est titulaire d’un
titre « absolu » de propriété et non fragmenté.
§ 2 Le tiers a
acquis le bien affidé de mauvaise foi
Le tiers sera considéré
acquéreur de mauvaise foi dès lors qu’il aura acquis le bien des mains du
fiduciaire en ayant connaissance de sa qualité de fiduciaire, ie en ayant connaissance de la
limitation de pouvoirs sur la chose aliénée qu’entraîne cette qualité. Précisément,
le tiers aura eu connaissance du fait que le fiduciaire ne pouvait lui aliéner
ce bien sans violer ses obligations.
La preuve de la mauvaise foi du
tiers acquéreur
Il incombe au
constituant, ou à ses ayants causes s’il est décédé, de prouver la mauvaise foi
du tiers et sa connaissance de l’existence du contrat de fiducie-sûreté car ces
éléments sont présumés.
Il n’en va
différemment que lorsque les biens et droits aliénés sont soumis à publicité
car on sait que dans ce cas, le nom du fiduciaire sera mentionné ès-qualités.
Dès lors, la qualité de fiduciaire sera opposable aux tiers lesquels ne
pourront plus se prévaloir de leur ignorance qui fondait leur bonne foi et
justifiait qu’ils bénéficient de la théorie de l’apparence.
Le law of trusts adopte une solution
équivalente puisque le système de publication de tous les estates et interests
existant sur une chose a pour effet de rendre opposable l’existence des droits
des bénéficiaires de trusts. Les tiers acquéreurs ne peuvent plus prétendre
bénéficier de la doctrine of notice.
Les conséquences de la mauvaise
foi du tiers acquéreur
Le tiers acquéreur
ne pourra pas se prévaloir d’un titre de propriété valable, il devra restituer
le bien en conséquences de l’exercice, par le constituant de son droit de suite
attaché à son droit à la chose, ou par l’effet d’une condamnation à réparer en
nature le dommage subi. En effet, sa responsabilité délictuelle pourra être
engagée sur le fondement de l’article 1382 dès lors que les éléments requis
sont réunis. Sa faute consistera en la violation d’une situation de fait qui
lui était opposable, situation de fait créé par le contrat.
S’agissant de
l’acquéreur d’un bien mis en trust,
en conséquence de sa mauvaise foi, l’equity
ne lui accordera aucune protection et le juge va juger en droit
, ie il analyse objectivement la
situation juridique des parties et suit les règles de common law.
Il en résultera que le tiers sera tenu de restituer le bien au bénéficiaire ainsi
que les profits qu’il en aura retirés. En effet, à titre de sanction, le juge
va présumer un trust implicite (constructive trust) et déclarer le tiers
constructive trustee du bien; or on
sait que le trustee ne devant retirer
aucun profit personnel de sa mission, il est tenu de restituer au bénéficiaire
l’enrichissement que lui aurait apporté, par exemple, la conservation du bien.
Là encore, on ne
pourra que regretter le recours à la responsabilité délictuelle pour aboutir à
un résultat, la rétrocession du bien au constituant, résultat qu’on pourrait
naturellement déduire d’un régime de la fiducie-sûreté reflétant réellement les
rapports qu’elle fait naître entre les parties. Mais notre droit commun, ses
auteurs, ses acteurs, refusent de faire preuve de réalisme.
Dès lors, pour
combler les interstices du régime de la fiducie-sûreté, nous pouvons
raisonnablement craindre que l’action délictuelle serve, pour quelque temps
encore, « de bouche-trou universel »
!
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi instituant la
fiducie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, sera présenté
à L’assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui
est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Chapitre
premier
Dispositions générales
Article
premier
Il est inséré dans le livre troisième du code
civil un titre seizième bis intitulé
« De la fiducie » et comprenant les articles 2062 à 2070-11 rédigés
ainsi qu’il suit:
« TITRE
XVI BIS
« DE
LA FIDUCIE
« Art.
2062. - La fiducie est un contrat par lequel un constituant transfère tout
ou partie de ses biens et droits à un fiduciaire qui, tenant ces biens et
droits séparés de son patrimoine personnel, agit dans un but déterminé au
profit d’un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux stipulations du
contrat.
« Le constituant peut-être bénéficiaire
« Lorsque la fiducie est conclue à des
fins de garantie, le fiduciaire peut être le bénéficiaire dans les conditions
fixées au contrat.
« La fiducie est soumise aux règles
ci-après énoncées sans préjudice des dispositions particulières d’ordre public
propres à la matière concernée.
« Art.
2063. - Le contrat de fiducie doit comporter à peine de nullité les
stipulations suivantes:
« 1° il détermine les biens et droits qui
en sont l’objet;
« 2° il définit la mission du fiduciaire,
ainsi que l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition;
« 3° il désigne les bénéficiaires ou fixe
les règles de leur désignation;
« 4° il indique les conditions dans
lesquelles les biens et droits doivent être représentés ou transmis aux
bénéficiaires;
« 5° il détermine la durée de la fiducie,
qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la date du contrat.
« Le contrat de fiducie est passé par
écrit. Lorsqu’il est conclu à des fins de transmission à titre gratuit il est,
à peine de nullité, passé devant notaire.
« La fiducie doit être expresse.
« Art.
2064. - Lorsque le contrat de fiducie a pour objet la transmission de biens
et droits à un ou des bénéficiaires autres que le constituant, la désignation de ce ou ces bénéficiaires ne peut être
modifiée.
« Art.
2065. - Si le contrat de fiducie conclu à des fins de garantie n’en a pas
disposé autrement, la valeur du biens transféré au fiduciaire doit, en cas de
défaillance du débiteur, être déterminée à dire d’expert, sauf s’il s’agit de
sommes d’argent, de créances, de valeurs mobilières ou de contrats cotés sur un
marché organisé.
« Art.
2066. - Nul ne peut être fiduciaire ou dirigeant d’une personne morale
fiduciaire, s’il a été l’objet d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer ou
contrôler une entreprise ou d’une mesure de faillite personnelle, ou s’il a
subi une condamnation pénale ou une sanction professionnelle pour des faits
contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
« Art.
2067. - Le fiduciaire doit exécuter personnellement sa mission. Toutefois,
il peut déléguer l’accomplissement de certains actes à une personne restant
sous son contrôle et sa responsabilité.
« Art.
2068. - Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer
des pouvoirs les plus étendus sur les biens et droits objet du contrat, à moins
qu’il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de
ses pouvoirs.
« Art.
2069. - Le fiduciaire doit prendre toutes les mesures propres à éviter la
confusion des biens et droits transférés ainsi que des dettes s’y rapportant,
soit avec ses biens personnels, soit avec d’autres biens fiduciaires.
« Sans préjudice des droits des
créanciers du constituant titulaires d’un droit de suite attaché à une sûreté
publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors le cas de fraude aux
droits des créanciers du constituant, les biens transférés au fiduciaire ne
peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de la conservation
ou de la gestion de ces biens par le fiduciaire.
« Art.
2070. - Lorsque la fiducie porte sur des droits et biens dont la mutation
est soumises à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire
ès-qualités.
« Art.
2070-1. - Le fiduciaire exerce sa mission dans le respect de la confiance
du constituant.
« Si le fiduciaire manque gravement à ses
devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant ou
les bénéficiaires peuvent demander en justice la nomination d’un administrateur
provisoire ou le remplacement du fiduciaire. Ils peuvent également demander
qu’il soit mis fin à la fiducie. La décision judiciaire faisant droit à la
demande emporte de plein droit le dessaisissement du fiduciaire.
« Les dispositions de l’alinéa précédent
sont applicables en cas de violation des dispositions de l’article 2066.
« Art.
2070-2. - En cas de décès du fiduciaire, les biens et droits objet de la
fiducie ne font pas partie de sa succession. En cas de dissolution d’une
personne morale fiduciaire, les biens et droits objet de la fiducie ne font pas
partie de l’actif partageable ou transmissible à titre universel.
« Art.
2070-3. - La fiducie ne peut porter atteinte aux droits des héritiers
réservataires. Si, lors du décès du constituant, la valeur des biens et droits
transférés au fiduciaire excède la quotité disponible, la fiducie est
réductible suivant les règles applicables aux donations entre vifs, sous les
particularités prévues aux articles 2070-5, 2070-7 et 2070-8
« Art.
2070-4. - La valeur des biens et droits transférés au fiduciaire s’impute
sur la réserve ou sur la quotité disponible de la succession du constituant selon les distinctions
opérées aux articles 864 et 865.
....
« Art.
2070-9 - Le fiduciaire peut demander la révocation ou la révision du
contrat de fiducie dans les conditions des articles 900-1 à 900-8.
« Art
2070-10. - La fiducie prend fin par la survenance du terme fixé ou la
réalisation du but poursuivi, quand celle-ci a lieu avant ce terme.
« La fiducie prend également fin par une
décision de justice, lorsque en l’absence de stipulations prévoyant les
conditions dans lesquelles le contrat se poursuivra, se produit l’un des
événements ci-après :
« 1° la renonciation de la totalité des
bénéficiaires ;
« 2° le décès du fiduciaire ;
« 3° la liquidation judiciaire du
fiduciaire ;
« 4° la dissolution de la personne morale
fiduciaire, le contrat pouvant cependant se poursuivre jusqu’à la clôture des
opérations de liquidation ;
« 5° la disparition de la personne morale
fiduciaire, par suite d’une absorption ou d’une cession prononcée dans le cadre
d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
« Toutefois dans le cas prévus à l’alinéa
précédent, le juge peut à la demande du constituant ou du bénéficiaire, prendre
toutes mesures permettant la poursuite du contrat.
« Art.
2070-11. - lorsque la fiducie prend fin, et en l’absence de bénéficiaires
pour quelque cause que ce soit, les biens et droits subsistants font retour au
constituant ou à ses ayants cause. »
Dossier étudié en Cabinet
Le dossier dont j’ai eu connaissance aux côtés
d’un avocat a inspiré ces réflexions. Si j’ai pu en mentionner, c’est avec
l’accord préalable de ce dernier à condition de conserver l’anonymat des
personnes concernées dans ledit dossier.
Ouvrages et articles
français
F.Terré, Introduction
générale au droit, éd.1991, Dalloz.
J.Flour & J.L.Aubert, Les obligations (1. L’acte juridique), 5é éd.1991, Armand Colin.
B.Starck, Droit
civil Obligations (2. Contrat), 3é éd.1989, Litec.
P.Malaurie & L.Aynès, Droit civil Les contrats spéciaux, éd.1994, Cujas.
C.Witz, Les opérations fiduciaires (Colloque de
Luxembourg des 20 et 21 sept. 1984), éd.1985 Feduci.
C.Witz, La
fiducie en droit privé français, Thèse Strasbourg, Economica 1981.
J.P.Beraudo, Les trusts anglo-saxons et le droit français, éd.1992, LGDJ.
D.Legeais, Sûretés
et garanties du crédit, éd.1996, LGDJ.
F.Collart-Dutilleul, Les contrats préparatoires à la vente d’immeubles, Sirey 1948.
R.David, Traité
élémentaire de droit civil comparé, Paris 1950, LGDJ.
Lexique de termes juridiques, 8é éd.1990,
Dalloz.
C.Larroumet, « La fiducie inspirée du
trust », Dalloz 1990 Chronique p.119.
M.Cantin Cumyn,
« L’avant-projet de loi relatif à la fiducie, un point de vue civiliste d’outre
atlantique », Dalloz 1992, Chronique p.117.
P.Gulphe, « Quelques réflexions sur
l’institution d’un trust à la française », Mélanges Breton-Derrida.
J. de
Guillenchmidt, « La fiducie, pour quoi faire ? Présentation de
l’avant-projet de loi relatif à la fiducie », Revue droit bancaire et de
la bourse, Mai-Juin 1990 n°19 p.105.
A.Pezard, « Les diverses applications de
la fiducie dans la vie des affaires » même revue p.108.
A. de Foucaud, « Le point de vue du chef
d’entreprise sur la fiducie » même revue p.114.
A. Cerles, « Le point de vue du banquier
sur la fiducie », même revue p.117.
Ouvrages et articles anglais
Maitland’s Lectures
on Equity (revised by John Brunyate), ed.1949, Cambridge University Press.
D.Chappelle, Land Law, 2nd ed. 1995, Pitman.
J.G.Ridall, The law of trusts, 4th ed.1992, Butterworths.
C.de Wulf, The
trust and the corresponding institutions in the civil law, 1965, Bruxelles.
H.G.Hanbury, Essays in equity (reprint of the edition Oxford 1934), Scientia
Verlag Aalen 1977.
Blackstone’s Statutes on Property Law, 1989,
Meryl Thomas.
Mozley & Whiteley’s Law Dictionary, 10th
ed., Butterworths.
International Encyclopedia of Comparative Law
(vol. VI).
V.Bolgar, « Why no trusts in the civil
law », The American Journal of Comparative Law, 1953 p.204.
F.H.Lawson,
« Non-roman elements in the civil law », A common lawyer looks at the
civil law (Lectures delivered by), 1977, Greenwood Press.
Jurisprudence
S’en référer aux
nombreux arrêts et décisions cités dans le développement.
|
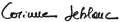
|
|
 http://corinne.leblanc.free.fr http://corinne.leblanc.free.fr
|
|
|